Inde : histoir d’un rejet « Déprime à Delhi », Janvier 1989
Préambule
J’avais projeté ce voyage dans le cadre de mon séminaire : d’un côté, je voulais voir si je pouvais appliquer mes méthodes d’analyse de films à des œuvres d’un monde différent, le cinéma indien, et d’un autre côté je pensais améliorer les conditions de travail de MW au Laboratoire audio-visuel, en y développant une « aile » d’analyse de films indiens. J’avais obtenu une mission de l’Éducation Nationale, en ficelant un projet de recherche qui, sans me convaincre moi-même, et avec un manque évident de préparation, avait toutefois convaincu le Ministère. Il s’agissait d’aller assister au festival international de cinéma à New Delhi, qui, je le croyais, projetait des films indiens. En fait, non, il était vraiment « international » ; il y avait bien une section asiatique parallèle, films indiens, films chinois projetés à l’Archana, grand cinéma un peu vieillot situé en ville. Mais les grandes projections internationales (non indiennes) qui constituaient le festival, avaient lieu à Siri Fort, dans un grand bâtiment neuf, loin de tout. Je ne découvrirais cela qu’en arrivant sur place. J’avais mal préparé mon affaire.
J’étais arrivée avec plus de 15 heures de retard, après un voyage sur la Thaï, et une attente d’autant à Roissy, transfert dans un hôtel, re-transfert à l’aéroport, allées et venues devant la douane, en raison des messages contradictoires de la compagnie. Finalement, au lieu de décoller un lundi à midi, on était parti dans la nuit du lundi au mardi à 3 heures du matin, où on nous avait servi un déjeuner comme s’il était l’heure officielle du départ, midi. Premières orchidées, premières hôtesses à la fois souriantes et glacées. On fonçait vers le soleil. Ça a tout de suite été le matin, et du haut de l’avion, j’avais survolé l’Afghanistan, je crois, ou le Nord du Pakistan, ses maisonnettes minuscules et caillouteuses si nettes dans un air d’une pureté hallucinante, puis l’Indus, dans sa plaine gris fer et lugubre. Je me disais qu’Alexandre avait dû se sentir bien loin. Moi aussi.
A l’aéroport de New Delhi, un employé indien de l’ambassade de France m’attendait, très gentil, il m’avait conduite à un hôtel au centre de Delhi, puis chez un opticien car j’avais perdu mes lunettes en faisant ma fiche de débarquement dans l’aéroport, elles seraient faites dans la journée ; il devait revenir le lendemain pour me conduire à un nouvel hôtel, plus proche du Siri Fort, où avait lieu le Festival de cinéma où je devais assister. Tout cela bousculait un peu. Surtout avec les heures de décalage, la fatigue et l’ennui des heures de retard.
J’avais trouvé à Delhi une atmosphère lumineuse, poussiéreuse et pauvre, qui m’avait un peu rappelé mon arrivée, jadis, à Mexico : le tiers-monde, pour faire court. Dans les arbres, j’avais vu de petits perroquets verts. Les rues étaient à moitié défoncées, la circulation anarchique, on roulait à gauche, mais en fait, on roulait n’importe où, on fonçait. Il y avait vraiment des vaches qui circulaient au milieu de la chaussée, faisant des embouteillages de bus crasseux et colorés, de rickshaws avec leur petite tente rayée, de taxis, de voitures, de charrettes.
Je copie maintenant le journal que j’y ai tenu, dans un grand cahier à couverture rouge. Je précise que je n’ai pas recopié les nombreuses fiches d’analyse de films, qui le parsèment, assez techniques, faites selon ma méthode (espace/temps/personnages) et trop systématiques pour qui n’a pas vu les œuvres : des films vus, je livre seulement des impressions ou quelques vagues résumés.
Le texte a le côté maladroit et brut de décoffrage d’un cahier tenu au fil des heures, je me suis sentie prise au piège pour trois longues semaines dans un pays qui m’est resté tout de suite en travers de la gorge. Plus qu’un voyage en Inde, il est un voyage en moi, à un moment un peu charnière dans ma vie professionnelle (tentative d’un nouveau terrain, non aboutie, mais qui a fini par redessiner mes perspectives) et affective (une réflexion et une mise au point au beau milieu de la cinquantaine).
J’ai hésité à placer ce texte dans la case « Espaces ». Car, plus qu’un déplacement, c’est la description sur le tas d’une sorte de panne, où j’ai eu la chance de rencontrer la gentillesse d’un Français qui habitait Delhi, dont M m’avait donné l’adresse à tout hasard, et qui a offert un cadre « transitionnel » à mon malaise et à mes réflexions. En lisant ce récit, il y a quelques mois, Clarisse Herrenschmidt, elle-même de retour de Delhi, l’avait baptisé « Déprime à Delhi », titre percutant et allitératif, Série noire à tendance psychologique, constat d’une incompatibilité, réflexions dans et sur une impasse.
Journal de Janvier 1989
1. Delhi, premiers contacts
10 janvier.
L’événement est d’abord la perte de mes lunettes [1]. Je les ai sans doute oubliées à l’aéroport en remplissant ma fiche de débarquement. Et cet énorme retard de quinze heures à digérer. Le gars de l’ambassade me trouve un opticien pour me les refaire, je les aurai demain. Tout ça prend du temps. Je dîne à l’hôtel, dans une petite salle à manger sombre.
11 janvier.
Me réveiller là, et me dire que je suis en Inde. Pigeons gris et petits perroquets verts à longue queue. Une ville énorme. Comment la comprendre ? Comme toujours, quand on est seul, j’ai envie de foutre le camp, pas tant pour rentrer chez moi qu’en fuite en avant, fuir n’importe où. Une évidence, un coup de foudre, dans le genre négatif. Certitude que l’Inde est comme un point d’orgue, avant une ère neuve, de tranquillité peut-être, des problèmes à régler avec moi et mes illusions sur les gens que je vois, qui me semblent indispensables et pour qui je ne le suis pas (S, F, JJ, il me semble que je les collectionne). Sur mon boulot à qui j’ai envie de donner un autre éclairage ou des manières de penser nouvelles.
Je me trimballe à Siri Fort en rickshaw, ça secoue vachement, en Inde, il faudrait porter un soutien-gorge armé jusqu’aux dents. J’ai traverse un bidonville immense et épouvantable.
Antaryali Yatra, film bengali, de Gautam Ghosh. Tragédie classique. Espaces : unité de lieu. Le bord de la mer, caméra frontale, découpage horizontal de la terre (village de pêcheur, sable) mer, ciel, en bandes +boue et tempête hyper métaphoriques. Temps : unité de temps, 24 heures. Drame de générations décalées, de traditions décalées, maladies surjouées, Pleurs longs et bruyants, avec des petits cris parfaitement stupides (de mon point de vue). Images bloquées comme les situations. Comme les gens dans la rue. On a l’impression qu’ils ne bougeront jamais.
Summer Night, Italie, Lina Wertmuller. Nul, je suis sortie aussitôt. Une caricature du terrorisme musulman.
14 h 30. Un film tchèque réaliste barbant, qui s’appelle A House for Two. 81 minutes. Milos Zabransky. Classique rivalité de deux frères qui ne sont même pas réellement frères. Classique à mourir. Fort maigres réflexions. Fiche faite avec « Personnages, espaces, temps », sans aucune créativité. Paysages industriels lourdement soulignés de symbolique pour montrer la lutte des classes. Je pensais pendant le film à comment je rentrerais à l’hôtel ( je me suis risquée à prendre un rickshaw), comment me partager entre le Siri Fort et l’Archana, comment vivre – dirais-je un peu supporter – ces trois curieuses semaines, me dire que dans trois semaines, en effet, j’aurai regagné le monde. Car je ne sais pas trop où je suis.Mais bon, je pensais surtout à ce que je pouvais conclure (enfin, espérer tirer) du cinéma comme ça, en dose. Ces plans agencés quand même uniquement pour illustrer. C’était flagrant dans le film tchèque. Des (gros) plans assez serrés avec des têtes, l’idée de mécanisme traduite d’une façon affreusement lourde, pistons, engrenages, roulements à bille. La symbolique désuète pour « exprimer » les dons du fils aîné (le cheval noir, la musique) qui sont ses hallucinations. La nièce (un prototype), les patrons, des employés sans personnalité, les copains du bistrot peut-être même « vendus » puisque presque insupportables.
À corps perdu, Canada, Léa Pool, 100 minutes. Sur la maladie, j’ai fait une fiche à part. Cela conforte ma thèse de transmission des maladies ou du moins des états où on y est offert par défaut de généalogie.
Tiens le sifflement du bistrot s’est arrêté, ça c’est appréciable.
Beau, Delhi ? Non, je ne pense pas, pas ce que j’ai déjà vu en tout cas. Curieux, oui. Triste en fait peut-être comme, non pas la mort (ajouté sans doute un peu plus tard dans la marge « si, si ! »), mais comme des souvenirs désaffectés (la vie du temps des Anglais), mêlés à une survie misérable de bric et de broc, un flirt permanent avec la menace de décomposition. Il me semble qu’on baigne dans une sorte d’angoisse de la minute qui va suivre. Peut-être que c’est cela que je ne supporte pas. J’avale quotidiennement, déjà depuis huit jours, car je l’ai commencé à Paris, le médicament anti-malaria. Infect. Il me dégoûte de plus en plus. J’ai l’impression d’avaler un poison. D’ailleurs, côté intestins, je suis déglinguée.
Lunettes : « Glasses », pas « spectacles ». Enfin, ils ont compris quand même. L’opticien me les a faites en un temps record et apportées à l’hôtel, le tout pour un prix dérisoire. Je serai le Brahmane de Tonnerres lointains, ce qui me ramène au Bonaparte, en décembre 1986, je crois, ou 85, c’est si loin et en voie de devoir être rangé [2].
Je change d’hôtel, le gars de l’ambassade m’en a trouvé un plus près de Siri Fort. J’y vais. Il a l’air minable. Et en fait, il n’est pas si près de Siri Fort. Je paye d’avance, la dame a l’air d’une tenancière de bordel et l’employé, d’un « cafard » aux yeux noirs. Ma chambre pue la naphtaline. Il fait glacial. La couette n’a pas de housse. Bon dieu, qu’est-ce que je fais là. Demain, j’appelle Henri, ce que je n’avais jamais pensé faire quand M. m’a donné son adresse « Tu verras, c‘est un de mes copains, s’il t’arrive quelque chose », mais que pouvait-il m’arriver, avais-je alors pensé, eh bien, justement, il m’arrive une panique, une immense répulsion, une angoisse, que je n’ai pas sentie depuis que j’avais onze ans un jour dans un camp de guides où on m’avait envoyée.
Le soir, vu Cry Freedom, Richard Attenborough, USA, 1988. Sur l’apartheid en Afrique du sud. Chiant. Partie, mais à onze heures moins le quart, d’où problème, aucun rickshaw, nul bus dans ce désert sinistre, sauf, au bout d’un quart d’heure l’arrivée d’une espèce d’escogriffe très grand et maigre et vaguement enturbanné, le sentiment d’être à la merci de ce rickshaw qui, s’il avait voulu, m’aurait effectivement plumée de 20 roupies, mais j’ai marchandé avec la dernière des énergies (c’est-à-dire payé quand même le double de ce soir).
Le 12 à 18 heures 30.
J’ai fait la connaissance de Vera Chytilova. C’est drôle, c’est une personne maintenant, pas seulement un nom de réalisatrice de la nouvelle vague tchèque. Charmante, belle, vive. Ça me fait une copine dans cet océan d’hommes aux yeux d’oiseaux ou de marrons d’Inde (naturellement), qui me fatigue. Je fais du racisme. Je suis vraiment atteinte.
Après un thé pris dans le hall minable de l’hôtel, hier soir, après ma sortie de Cry Freedom, pour me réchauffer, je n’avais pas dîné, j’étais glacée, et où l’employé de la Poste m’a ouvertement draguée, j’ai très mal dormi, pas parce qu’il m’avait draguée (bien qu’il a eu le culot d’appeler au téléphone une fois que j’étais remontée dans ma chambre, en début de la nuit), mais parce que j’avais froid et parce que j’avais à organiser la visite à Henri P et la Poste pour une lettre à Bernard. Mon anglais est à la peine. Tout me semble une montagne.
Avec un taxi et 60 roupies, j’ai ainsi fait un énorme tour, très utile et très beau, avec des contrastes fous, la verdure merveilleuse des beaux quartiers, où se trouve la maison de HP, puis traversé les bidonvilles effroyables, auprès desquels ceux de Mexico paraissaient des lotissements habitables, la grande salle de cinéma, ses sièges durs, très cinoche du tiers monde, froid, cheap, avec un immense balcon raide. Ah là là, les films ! Je repense à Antaryali Yatra, le film bengali avec la jeune fille mariée avec un vieillard qui n’en finissait pas de mourir, au bord d’une mer sur une plage immense, tout filmé frontalement, découpant l’espace de l’écran en étages impeccablement horizontaux, ciel, mer, sable, avec un bateau orné de deux yeux peints. Elle était la fille du brahmine, et elle devait donc pour respecter et restaurer (j’ai manqué heureusement la moitié) la tradition : périr sur un bûcher. Elle et son père passaient leur temps à pleurer, le vieillard à ressusciter et à minauder. L’intouchable tournait autour, en poussant des chants de mort. Il précipitait le vieillard dans la vase, elle essayait de tirer le vieux de là, l’intouchable était (touché) blessé par elle dans une grande colère qui s’achevait dans les bras de l’intouchable, tous deux gluants de boue et elle pleurant. Le lendemain, le vieux, par miracle, sur son lit de repos blanc sous le dais à fleur, réclamait un miroir, s’admirait, réclamait du lait de la chèvre de l’intouchable. Re-scène d’amour de la fille du brahmine et de l’intouchable. Enfin, scène « évoquée »… Même dans la boue, elle était si nette. A la fin, la marée montait, la tempête faisait rage et tout le monde se noyait, elle à la poursuite du vieux, l’intouchable à la poursuite de la jeune femme. Dans la salle, quelques rires sur les minauderies du vieillard mais pas sur le problème des relations, le poids des dieux dans la société, ni sur l‘effrayant larmoiement, la longueur des gémissements, on sent que cela est « normal » à voir, pas lassant, alors que c’est vraiment une autre conception du temps du spectacle. Pour moi, exaspérant. Ne me donnant déjà plus envie de travailler là-dessus de près ou de loin. Le poids gluant des divinités implacables.
Dans Delhi, la population passe son temps, les uns à circuler comme des fous, les autres à « attendre », assis sur leurs talons, à ne rien faire, toujours est-il que ce pays est en fait de l’ordre de l’Autre total. Rien à quoi se rattacher. Même pas leurs visages d’oiseaux, ils ressemblent à des merles, avec leurs yeux brillants et fixes (ils n’ont pas l’air de voir), leur air chétif, finalement proche avec les Mexicains lorsque j’étais arrivée à Mexico (pas à San Luis, le rapport était différent, et puis, c’était devenu chez moi). Les Français sont moches aussi, mais il y a une meilleure proportion, taille, croissance, ici, on voit à l’œil nu que ces gens sont pourvus d’une espérance de vie minable dans tous les sens où on peut pousser cette expression. Et on n’y peut RIEN !! Je manifeste cette dimension d’incompatibilité, avec la cuisine. Les odeurs des épices me fatiguent. J’ai mangé ce soir une soupe au poulet, une pizza, et constaté, comme ce matin, que les choses, p. ex. le café et le jus d’orange, avaient le même nom mais pas le même goût, c’était des réalités complètement différentes : c’est comme la remarque que m’avait faite A. un jour à propos des mots qu’employaient les Africains parlant français, c’étaient les mêmes que les nôtres, mais pourvus d’un sens acquis dans la différence des contextes. Les autres films, peut-être que je n’en ai rien dit ? Le Canadien (français) : deux homos, une nana, elle musicienne, un des hommes est photographe de grand reportage, l’autre zoologue. Tout le monde se largue, finalement. Le photographe abuse de ses photos pour dire sa mémoire, les deux autres sont plus flous. Il y a aussi un sourd muet, qui veut se distraire et réchauffer le photographe, quand à son retour du Nicaragua, il se retrouve largué par le zoologue, avec le chat. Certains plans d’intérieur assez léchés. Assez beaux, même. Mais l’histoire est à la fois banale et clin d’œil à la mode actuelle, elle fait penser à Sunday, Bloody Sunday, que j’ai revu à l’instant mais qui, lui, tient très bien le coup.
Dead Ringers [3], David Cronenberg (avec Jeremy Irons dans le rôle des 2 jumeaux). Film magnifique, bien que pas sous titré j’en ai donc perdu une partie, mais pris suffisamment de notes, et fait une très longue fiche d’analyse de plusieurs pages. Tous mes thèmes y sont comme magnifiés. Maladie, folie, généalogie etc.
Ce qu’il est moche, cet hôtel, c’est un vrai scandale quand je pense au prix de leur infect petit déjeuner minable, c’est à pleurer.
(ici, un décompte des jours de la semaine, barrés à mesure, a posteriori).
Que c’est triste Bloody Sunday, j’avais oublié comme la finesse de la tristesse et des téléphones est bien rendue, saisie.
A faire : le musée, jardin zoologique, demander à Henri P des trucs et des idées de visites. Madras absolument.
13 au soir, vendredi.
En France, Paulette a dû être opérée. Brigitte doit vivre la dernière journée de pharmacie avenue du Maine. Je serais bien à Paris (c’est vrai que c’est assez hostile cette civilisation hindoue, si bien représentée dans son écriture terrible à voir et qui n’est pas sans ressemblance avec celle, que j’aime si peu, des tags du métro.
Madras, billet pris. J’ai fait un tour énorme dans Delhi ce matin. Vu deux Canadiennes qui m’ont donné l’idée d’une promenade de touristes dans Delhi pour essayer de « couvrir » la ville. J’en vois à peu près bien maintenant tout le sud de Connaught Place.
A Connaught Place, je m’attendais à voir Tante Paulette au bras de Rudyard Kipling, toute l’atmosphère y était. Démodée. Comment est Madras ? Aussi dure ? Il faut que je demande au gars de l’ambassade de me donner l’adresse de l’agence de voyages, pour peut-être faire changer mon billet de retour d’Air India de Madras pour la veille au soir et surtout retenir une chambre à l’hôtel Atlantique. Je pense que Bombay serait pire que Delhi, dans mon imagination du moins, dans la dureté.
Films : hongrois, Just like Amerika, Peter Gothar, 120 minutes, histoire de ce mec qui décide de se perdre à New York où il est venu avec un voyage organisé avec sa femme et sa fille. C’est pas mal, un peu long. Les Indiens n’aimaient pas, visiblement. Notamment le plus beau plan sous le tunnel derrière les essuie-glaces. J’aurais voulu qu’il ne finisse jamais et je m’angoissais de savoir comment il allait le finir par l’arrivée dans un des docks. Le cinéma de référence (l’occidental) montre du cinéma d’évasion, oui mais ce n’est pas n’importe quelle évasion, ce cinéma jouerait peut-être le rôle d’une chanson pour Distant Voices, un monde où ce serait comme on le dit, avec un bonheur fou, des malheurs qui s’arrangeraient, alors que c’est le contraire. En tout cas, qu’il y ait un type de cinéma occidental ne fait pas de doute (vu de loin de l’Occident). Pourquoi ? D’abord le rythme, (le rythme lent de Satyajit Ray qui est esthétique pour nous, alors que le rythme du bengali hier n’était pas pour moi esthétique mais insupportablement cucul, concon, mélo, ridicule etc. non signifiant sinon un empâtement de l’expression. Les Chinois sont dans le réalisme asiatique (c’est à dire l’illustration plus ou moins léchée d’épisodes de la révolution (du quotidien comme Un Eté chez Grand-Père, Hou Hsiao Hsien, taïwanais donc assez occidentalisé). On est en plein dans La Cinquième génération (dans la marge : On dit que c’est l’âge d’or du cinéma chinois, renouveau et liberté des années Quatre Vingt après la période maoïste. )
Le film yougoslave ? A film with no name, 100 minutes, Srdjan Karanovic. Hôpitaux, prisons, appartements privés, utilisation de la video pour mémoire, pas mal, un peu long, genre téléfilm, lien Médecin/Police évidemment, mais « le bon » médecin (qui évidemment ne soigne pas), laisse échapper la fille.
14 janvier.
Un retard épouvantable de prises de notes, faute de lieu confortable. Je dois demander où aller à Henri P, il doit connaître des hôtels moins moches, quitte à perdre complètement mes sous [4] : cet hôtel est décidément insupportable et même horrible, malgré les « Madam » royaux dont me gratifie la grosse propriétaire. Froid, sale, voleur, inconfortable, sans lumière, enfin bref tout ce qu’on peut concentrer de pire, pour un lieu qui devrait être de repos. Bref, le film yougoslave, je n’en ai rien dit, la maladie est construite de façon classique ; c’est drôle aussi, cette allergie du nez que j’ai parfois à Paris, mais qui est spécialement irritée ici, air sec, il saigne ? Peut-être la naphtaline, la poussière, l’odeur de fringue indienne sucrée et poussiéreuse. Oh oui, je ne les aime pas ni l’extrême appuyage des films indiens, lourdeur, insistance, redondance, classicisme du montage, et des signes. Écrasement des vies tracées par la tradition.
Le film chinois Hibiscus Town, Chine, Xie Jin, ce matin, était un genre de chef d’œuvre (2 h ½ environ et ils ont ici un entracte de 10 minutes) sur les problèmes des différentes campagnes politiques dans le fin fond de la campagne précisément. Avec la touchante opposition de la « camarade » en gris à peu près indestructible, combinarde, représentant une sorte de fatalité d’en haut qui doit bien valoir la pesanteur des régimes précédents, et les pauvres si bons, le « Mad Man » droitiste, antirévolutionnaire, empoisonné en 1966 pour adultère, et la riche paysanne qui devient veuve, s’éprend du Mad Man, en a un enfant ; à la fin, ils se retrouvent. Une quantité de plans sombres, on ne voit rien, c’est tout le temps la nuit, ils balayent des rues en pierres grises, entre des murs gris foncé. Des séquences d’une longueur pas possible, pour exprimer une situation d’une aveuglante simplicité, en somme on dirait qu’en Orient, ils ne s’attardent qu’à des plans qu’on supprimerait en France ou en Occident en général. Aux États-Unis surtout, où ils ont un sens du rythme unique, jamais une seconde de trop dans un plan. Par exemple, le vomissement de celle qui est enceinte, et le cri du bébé pour annoncer le plan de la clinique, et puis, eux aussi, ils pleurent tout le temps, ils poussent des cris, des gémissements, en Chine comme en Inde, d’une démonstrativité et justement, ils montrent multipliés par deux, trois ou dix, en temps, en visuel, en sonore, tout est de fait complètement téléphoné, il n’y a jamais la surprise de se demander, « mais comment vont-ils se tirer de ce plan », en fait ils ne s’en tirent pas, ils l’épuisent, sous une seule face. (Je crois que c’est assez bien vu, comme quoi, il suffit d’une table pour penser et des lunettes pour voir).
J’ai donc vu aussi en retard le film de Vera. Pas désagréable, The Jester and the Queen, même si elle aussi tire en longueur. Elle aussi, elle a une situation et elle l’exploite, mais elle a une idée, des acteurs et de l’humour sur ses personnages. Il est une heure et demie. L’ennui, c’est vraiment que le film tamoul ne soit qu’à trois heures et demie, ai-je le temps, le devoir, de me rendre dans mon horrible hôtel, me reposer et repartir pour Archana Cinema ? De là chez Henri P ? Mais en même temps, me taper « Le commissaire », d’Alexander Askoldov, URSS, je n’ai guère le courage, ou alors ¾ d’heure de « Kommissar » chiant, puis le film tamoul. Cela ne serait pas spécifiquement bête.
C’est ce que j’ai fait. J’ai même posté une lettre pour Paulette.
Quelle idée de génie d’être rentrée. Si déplaisant soit cet hôtel, quel repos. J’ai encore une heure et demie à traîner sous cette couette qui pue la naphtaline. Et je n’arriverai pas chez Henri P comme un paquet de chiffons.
J’ai fait aussi mon plan touriste, Madras et l’ensemble des temples de Mahâbulipuram.
Je dois encore une fois compter combien j’ai de dollars. Savoir que je peux prendre l’équivalent de 2000 francs ? À l’American Express dans la semaine ?
Le 14 au soir.
Je suis allée au dîner chez Henri P. Et chose inattendue, j’y suis restée coucher. Pris en haine absolument l’hôtel, cette chambre immonde, mon petit déj. servi sur une feuille de papier journal en guise de napperon, trop, c’est trop. J’ai donc dormi chez HP après un dîner excellent avec lui et une amie à lui, Silvia, très agréable, je revivais, est-ce vraiment seulement cet hôtel qui explique mon horreur de cette ville, en fait, j’ai manqué peut-être la vraie déprime de peu, je ne m’en rends compte que maintenant, car je sais que je vais sortir de cet hôtel. Quand j’ai demandé conseil pour déménager, Henri m’a invitée à venir chez lui, le plus simplement du monde - il a une maison, une chambre d ’amis et un jardin, - pendant environ une semaine (après il part en voyage et moi, je pense aller faire un tour à Madras). Ce jeune homme est d’une gentillesse et d’une simplicité qui me renversent. Sa maison et son jardin sont des plus plaisants. Il a un domestique qui semble sorti d’un roman de Kipling.
2. Delhi, chez Henri
Le 15 au matin, j’ai été chercher mes affaires dans l’horrible hôtel, puis je suis allée à Siri Fort qui était plein de soldats avec leur gourdin ou leur longue latte. J’y ai vu un film soviétique, Living Legends, de Nodar Managadze, assez beau, tourné dans le Caucase. À propos, j’ai vu un gros camp militaire près de Mathura, qui n’y était pas me semble-t-il, canons, très engageants, Siri Fort était détestable, ce festival est détestable, je ne sais même plus ce que j’ai vu, mais je vais bosser dans 5 minutes sinon, c’est la pagaille définitive. J’ai vu, par erreur de cette espèce d’epsilon (A. Huxley a dû aller en Inde) qui conduisait le rickshaw, le magnifique Purana Qila. En fait la seule chose m’ait touchée jusqu’à ce jour.
Le soir, nous sommes allés dîner dehors, dans un grand hôtel assez chic, avec des amis d’Henri, un couple qui travaille dans je ne sais quel institut culturel, lui est fasciné par la fascination que les Anglais ont gardée pour l’Inde, elle à cause des impressions de route de son routard de frère. En passant, je note avec une extrême stupéfaction que les routardes aiment l’Inde ou plutôt se sentent bien dans cette survie agitée et nulle à la fois.
Quelle horreur en fait, ce pays, c’est bien ce que je pensais, je n’ai jamais eu envie d’y aller et j’avais absolument raison. C’est répulsif. J’ai dû mettre à peine une demi-journée à m’y sentir mal. Et en trois jours, horriblement mal.
16 janvier.
Film chinois de kung-fu, Golden Dart Hero, Li Wenhua, étonnant, quelques scènes très belles, malgré la « sombréité » absurde de leurs pellicules. (En fait j’ai appris que le sombre vient de la mauvaise qualité des projecteurs, et de leurs lampes faiblardes, pas du tout de la qualité des pellicules). La Chine offre du nouveau. Elle me séduit, à travers ses films. Une sorte d’entêtement, au lieu de l’acceptation genre « chien crevé au fil de l’eau » que je trouve en Inde.
Rencontré Janet Fine qui m’a emmenée à l’hôtel Ashok (où l’ambassade aurait dû me loger, tous les gens du festival y sont et cela m’aurait changé la vie sans doute) et inscrite sur la liste d’Agra. Je ne sais pas si j’irai, j’aimerais mieux, je crois, y être toute seule comme dans mon plan primitif ou plutôt second. Ou ne pas voir du tout ce temple, cette chose trop léchée que tout le monde admire sans la regarder.
Red Sorgho, de Zhang Yimou. Le film a beaucoup plu à la salle. À moi, moyen, je l’ai trouvé un peu trop travaillé, par rapport aux autres films chinois que j’ai vus dans ce festival, mais qui faisaient partie de la section parallèle ; Red Sorgho, plus classique, plus empesé, était dans la sélection officielle parce qu’il était déjà eu l’Ours d’or du Festival de Berlin. Delhi ne passait pas que de la Ière diffusion, loin s’en faut. Tous les « bons » films ont déjà été primés ailleurs. Il n’y a pas de prix décerné, c’est seulement une « aide » pour faire diffuser les films en Asie. J’ai mal choisi mon festival. La section populaire asiatique, hors de Siri Fort, est de loin la plus vivante.
Demain, j’irai au film chinois dans l’autre salle, puis au Tourisme.
La garden-party, dans le jardin du Gouverneur, où les étrangers du Festival étaient invités, auteurs et critiques, était du dernier kitsch, je trouve, j’ai toujours l’impression d’être une guenon dans ce genre de festivité. Là, c’était le bouquet. Femmes en sari, ou en chapeau et tailleurs pantalons, talons aiguilles dans l’herbe des pelouses, buffet excellent et mixte. Retour très tôt, 4 heures. J’avais des cartes postales, l’intention de faire quelques fiches, et de me laver les cheveux après un quasi étourdissement à Connaught Place. Pourtant j’avais mangé à la garden-party. Demain, il faut absolument que je calcule si j’ai intérêt à prendre une chambre pour trois nuits au Hans Plaza, l’hôtel moyen de mon arrivée, assez bien situé, tranquille, propre. + Agra. Ou une chambre au Ashok pour Agra gratos. Au Ashok c’est au moins cent dollars, au Hans Plaza il faut absolument que je sache. Dimanche midi, je fais ça comme décision. Voyons, réfléchissons (suit une liste de jours barrés). Ou un taxi pour 6 heures moins le quart, soit à cinq heures et quart vendredi, ce qui est horrible, car ça fait tellement tôt. Partir dans la nuit noire à la station ?
17 janvier.
Film chinois hier The First Woman in the Forest,,Wang Junzheng, 1987 : la vie des forestiers et des putes à forestiers. Ces Chinois ont vraiment du talent. Je viens de voir (je suis sur la terrasse d’Henri, quelle douceur pour un 17 janvier, j’ai toujours l’impression que je me trompe de mois quand je mets la date) une Indienne très jolie avec un hideux loulou de Poméranie complètement kitsch et français de vue et de comportement. (suivent quelques additions de chiffres, barrés). Après le film, j’ai été avaler une soupe à Siri Fort, acheter des catalogues du festival où j’ai été scandalisée que les films indiens ne figurent pas. Décidément, ils se font bien à eux-mêmes une ségrégation complète. Puis, je suis allée réserver mes chambres (en clair, organiser mon évasion de Delhi en deux temps, Madras, puis Paris) puis enfin au musée décevant, plutôt chiant même, soyons franche. De jolies miniatures. Mais pas une carte postale, pas une cafétéria. Ce n’est pas un pays pour moi.
Demain, j’irai peut-être à Red Fort. Je vais un peu lire mon guide et bosser.
C’est quand même un vrai problème de savoir comment on peut supporter de vivre ici. Quelque chose m’échappe complètement. Chez moi, il y a un refus de prise en charge de l’aspect pauvre, misérablement profiteur sur 3 roupies, qui en fait m’exaspère (comme à Matmata par exemple où j’étais animée des pires désirs racistes, ignobles, de bazooka). Je n’arrive pas à penser tout à fait que j’ai mauvaise conscience. C’est autre chose que je n’arrive pas à voir, on n’existe que comme vache à lait possible. Non, c’est autre chose. C’est le sentiment des alpha sur les epsilon et on sait que ce sentiment vous fait participer d’une certaine manière à leur immonde système de castes. Ce n’est donc pas agréable. Je ne m’aime pas.
Et puis aussi sûrement la violence. On la sait par on-dit, par les journaux, les faits. Mais est-ce qu’on la voit ? Oui, dans la circulation, c‘est sûr, elle n’est pas normale, même les Italiens autrefois n’avaient rien de cette nécessité, de cette fuite en avant et du moi d’abord et tant pis ce que ça coûte à tous risques. Quand on risque si fort sa vie pour si peu, est-ce que cela ne veut pas dire la violence (ce qui signifierait un état d’après la perte de qq chose, le à quoi bon, le non-espoir). (Dans la marge, une note ajoutée : c’est un jeu à Madras, une violence à Delhi). Passer ou crever, mais passer pour quoi, pour rien, ce qui est une alternative inexistante, rien ou rien. Ça c’est un point, c’est pourtant peut-être faux, juste une vue de moi, eux pensent peut-être qu’ils ont la vie devant eux. Ils font comme s’ils ne l’avaient pas, cependant. (Ils ne l’ont pas, de fait).
Et plus je pense, plus la division d’Huxley convient : il y a vraiment toute la gamme et même des sous epsilon qui sont les mendiants, des sortes d’omega, de têta. Je suis horrible. Rendue horrible.
18 janvier.
Break. Mercredi ? Pas bougé. Ouf. Pensé que le 25 au matin je prends le meilleur hôtel de Madras pour le 25 et 26 et je leur demande une voiture pour le 26 pour aller à Mahâbalipuram où je passerai donc la nuit du 25/26 et 26/27 soit le mardi ? et le vendredi aussi.
(Suit une liste de cartes postales à faire et quelques gribouillis sur les jours prévus à Madras).
Mais risquer sa vie pour si peu (circulation) ça veut dire que la vie est si peu, pour soi comme pour les autres. Une journée à ne rien faire qu’une reconstitution. Je pense qu’elle suffira. Demain j’irai à Fort Rouge le matin, puis à Bhak voir comment m’y rendre, leur dire de m’envoyer un taxi ? Peut-être ? Car je ne voudrais pas rater ce foutu car en m’y rendant par mes moyens, j’aurai cent ou cinquante roupies de taxi au lieu de cent dollars pour une chambre.
Ah oui, je hais ce festival, la ville, les gens, l’air, je ne vois plus rien, les lauriers sont coupés. Je suis donc bien dans le milieu du sas et j’en reviendrai comment ? Transformée ? Soulagée ? Contente, étonnée ? Et je me hais aussi, de profiter si mal d’être ici.
Avec les projets de boulot, je vais accoucher d’un bouquin presto, oui, sans doute. ( Le roman n’est pas en vue) sur la maladie (au cinéma) car je suis à la fois toujours au clair et pas au clair. On est malade pourquoi ? Parce qu’on n’a plus ses parents ? Ou bien quand on est malade, en plus, on n’a plus ses parents ? C’est-à-dire qu’on est dans la perte généalogique, physique et qu’on y range, qu’on y cache, qu’on y joue , ou qu’on y fait un excès ?. (Dans la marge, « C’est-à-dire qu’il y a combinaison de deux pertes ? Ou bien que la maladie frappe des êtres déjà affaiblis. Par leur généalogie qui en somme les protège si elle est complète ?).
(Quelques notes disparates suivent) L’histoire des connexions, du repérage des connexions fréquentes et moins fréquentes. Le rêve (Freud) il ne crée rien, il transforme. N’est-ce pas aussi le cas du cinéma dans l’épineuse question du réel. J’avais vraiment besoin de ce break. Et dans les connexions, celles qui sont des éléments du répertoire, catégorie par catégorie ? Ou qu’est-ce qui me fait parler, écrire (roman) écrire (boulot), une sorte de catharsis pour connaître enfin les vraies valeurs, l’amitié à coup sûr. « Je ne saurais pas ce que je dirais, ni à qui je le dirais ». Est-ce qu’il n’y a pas de généalogies dans les films ? Si, ce sont des histoires de famille toujours, normalement puisque c’est en relation avec le monde et que la famille est une base du monde.
Objet donné par la création d’un espace. Ce peut être un « objet perdu » pour le créateur. C’est peut-être pourquoi les réalisateurs parlent, à nos yeux, si mal de leurs films c’est qu’il est à leurs yeux un objet perdu re-construit et que pour nous autres analystes, il s’agit de construire un objet de recherche (où nous nous inscrivons, nous, forcément) et sans le souci de cet objet perdu qui est à l’origine du projet du réalisateur. Nous voyons l’objet créé, pas le perdu. Il se peut d’ailleurs que nos constructions fassent apparaître des filigranes nouveaux, non vus par les auteurs. Par exemple, les remarques que m’a faites Jacques de Decker à la TV à Bruxelles, sur le personnage si important de la mère dans mon roman ; et Gilles sur la quête de « la mort enfin » ; ou le plaisir de Deville à lire les conclusions de Deligne sur les seuils /et les hommes et les femmes de Péril en la demeure, que l’auteur lui a dit les avoir faites sans les voir.
Et cela donnerait le ratage de Rouch sur Dionysos, un objet perdu, tenté d’être retrouvé brut , et trop tard, avec toute la naïveté un peu niaise de sa génération ?
(Ensuite, j’ai passé des pages, sans que je comprenne pourquoi, la suite du 18 janvier se trouve après le 19. Mais je le replace ici, à la bonne place du 18 janvier. C’est déjà assez décousu comme ça, comme texte. Il semble que je sois toujours dans le jardin d’Henri)
Il y aurait ce vieil homme accroupi dans la pelouse et ces lunettes très lourdes et ce bruit bien pire que celui du Bd Blanqui. J’ai grand peine à penser que Paris est gris, peut-être froid. Madras, ce sera l’été, chaud ? La grâce des vélos-taxis muets glissant avec des gens dedans, comme un rêve au lieu des hurlements hargneux des rickshaws. Non, le vrai problème, c’est comment aimer l’Inde ? Que « leur » manque-t-il, pour faire la jonction avec une vie sans ce je ne sais quoi, je ne peux pas dire « hostilité », cette dureté, oui, on est comme un animal accroché à une paroi de pierre ou de bois ou de bronze au lieu d’une paroi en coton ou en beurre. « Ocnophile », qui ne peut quitter son objet rassurant. Philobate : un milieu, là, en Inde, c’est mon espace philobate qui en prend un coup, pour mon côté ocnophile, j’ai Henri, le transitionnel idéal. (Longue note ajoutée en 2013 : Apparemment je devais être en pleine lecture de Balint et de la Gestalttheorie, car ces termes qui dépeignent le rapport à la sécurité me semblaient alors très familiers, alors qu’en 2013 où je « saisis » ce journal, j’ai dû les rechercher dans le dictionnaire… Les retrouver aujourd’hui montre combien j’avais bien l’impression d’être en pleine régression. Rappel : l’ocnophile ne peut se séparer de son espace, le philobate court de lieu en lieu. « Le terme ocnophile vient du grec OKNEO qui veut dire se dérober, hésiter, se cramponner, renâcler. Le terme philobate vient du mot acrobate, celui qui marche sur les extrémités. Dans les deux termes il y a phil, celui qui aime, qui choisit de… Prenons l’exemple d’un chemin avec des poteaux tout le long, l’ocnophile serait celui qui se cramponne à un poteau sans oser le lâcher. Le philobate serait celui qui passerait son temps à courir d’un poteau à l’autre, sans pouvoir se fixer à l’un d’eux. » (Marie Boutrolle). Et le même auteur écrit encore « L’ocnophile a l’illusion d’être en sécurité tant qu’il garde le contact avec son objet, et que ce dernier « collera » à lui. Le monde de l’ocnophilie est structuré par la proximité physique et le toucher. Dans cette configuration, l’objet d’attachement de l’ocnophile n’a aucune liberté, lui non plus. S’il exprime le moindre désir d’indépendance, ou s’il esquisse la plus petite mise à distance, l’ocnophile pris d’angoisse, resserrera son étreinte… Le philobate peut abandonner (ses bons objets) et revenir les rechercher à sa convenance, sûr de pouvoir les retrouver là où il les a laissés. Il peut aussi aller en trouver d’autres ailleurs. Ils sont en effet interchangeables à ses yeux. Son monde est structuré par la distance et la vue. Il a l’illusion d’être en sécurité tant qu’il peut dominer le paysage et voir ce qui s’y passe. »)
19 janvier.
Les jours passent très lentement. Mais je suis aujourd’hui sur la crête du séjour. Le compte à rebours positif va pouvoir commencer. Dirai-je que j’en ai vraiment besoin ? De plus, cette espèce de diarrhée jamais tuée était symbolique, je chie l’Inde et en même temps, je ne l’avale pas, (donc je meurs) ; c’est d’ailleurs une très intéressante expérience. Plus dure que je ne croyais : je me voyais moins, non pas étrangère, ça je savais que je le serais, mais en tout cas moins mal à l’aise. Je pensais que je le serais et par moments, il me semble, que je déploie une énergie inutile à me sentir environnée comme par de l’hostilité.
Peut-être en tous cas faut-il décider que je ne vais plus du tout au cinéma. Car j’en ai ras le bol de ces lumières hésitantes, de cette salle froide et loin de tout. Je me rappelle combien Raman, le premier jour, prenait un air chagrin quand j’évoquais l’Archana, ce que je comprends. Ce doit être un des cinémas cheap et complètement crade et il devait me voir avec peine par ici. Quant à l’autre, ses soldats, sa prétention, me tuent. C’est un très mauvais festival avec des films déjà tous sortis et certains très désagréables. Ce matin, le journal était bien critique sur le film indien, disant qu’il n’y avait plus que de la merde.
Il faudrait que j’arrive à analyser mes réactions phobiques. Elles logent dans le tube digestif. Je ne saurai jamais pourquoi. Et même si c’est parce que la première agression subie est localisée là (à ma naissance, lait maternel reçu comme un poison) c’est drôle que ça marche encore. Ca a toujours marché là depuis que je me souviens. Bon, ça n’a qu’un intérêt moyen. Il faut que j’essaye de voir si une véganine me relaxe ce soir. Codéine, oui, sans doute.
Mais en attendant, c’est vrai que je suis fatiguée, que je dois raisonner en compte à rebours. Il y a la semaine prochaine assez animée. C’est juste cette fin de semaine un peu désemparée avec la haine du festival, la non-envie d’Agra, depuis toujours et ravivée par la trouille du taxi et de mes intestins en capilotade. (Suit un petite liste de jours et de nuits avec les lieux à venir) Comment raisonnablement pourrai-je ne pas être morte ?
Oui, il faut que j’arrive à un peu raisonner et maîtriser cette panique à demi hystérique, produite en colique et en refus de sortir. La dire, l’écrire, la ridiculiser d’une certaine manière en mettant à plat cette femme de 56 ans (c’est pourtant vrai) réagissant comme je le ferais à douze ans. Je suis une femme de 56 ans qui a la chance d’être encore pour dix jours en Inde aux frais de la princesse et qui n’arrive pas à s’y détendre, ni y dormir, ni y manger. C’est bien cela qui est le plus curieux. Mais je crois qu’en effet, le fait de l’écrire déjà d’une main ferme à une table ferme est un point. Un autre point, d’avoir éloigné un Surmoi : le Festival, il me fait chier tout à fait, (c’est d’ailleurs le cas de le dire…) donc je ne vois pas pourquoi je me forcerais à galoper dans ces lieux laids avec des cons voir des choses chiantes. Et aussi d’avoir décidé qu’Agra, comme à mon premier mouvement, je n’y allais pas. D’abord parce que tout ce monde y va, ensuite parce que je suis crevée, ensuite parce qu’il faut se lever à 5 heures du matin et guerroyer contre moi même pour avoir un taxi. Pas le courage.So. Ciao.
Ce point étant éclairci, la journée se tirant avec des lectures très positives (Freud/cinéma/rêve/image), la soupe au poulet (nourriture humaine) sentant bon, et ma chiasse d’hier semblant bloquée, je me sens effectivement mieux. En rentrant à Paris, penser. Et puis retrouver P. Quignard, je ne sais que lui envoyer comme carte ?
Autre raison excellente, le Post Office est vraiment tout près. Je pourrai donc y envoyer sans crainte la dernière lettre à Bernard. Voire, y racheter des timbres. La tombe de Khan Ikhan superbe avec son bouquet de vautours sur le toit arrondi. Peut-être que ce pays est en effet une énorme figure de la Mort et que les gens qui y sont son en liaison avec la Mort même. (en note dans la marge : le métier d’ethnologue est un métier de fou total, sauf pour des « mixtes » comme Condo, sans doute. Mais les autres ? Et ceux qui l’aiment auraient-ils un problème avec la pulsion de mort ? )
De plus, je suis sortie, j’ai donc réussi à vaincre aussi cette peur invraisemblable du vaste monde, qui m’est généralement tout à fait étrangère, qui n’en est pas moins réelle, car je suis tout de même étrangère justement, étrange, à tous les titres. En Inde, enfin, à Delhi, je suis absolument le contraire de ce que je suis, c’est sans doute ce qui cause ma haine et mon malaise, je ne me reconnais pas.
J’y suis comme quelqu’un d’autre, pas sympathique du tout.
Lenteur des heures. Soleil voilé. Un temps assez doux dehors. Vent froid de l’Himalaya.
20 janvier (vendredi).
Ce matin, il fait encore beau, chaud, dans le jardin où je lis Duras. D’avoir réparé mon tube digestif grâce à l’Intétrix et à la soupe de poulet délicieuse fait par le domestique indien d’Henri et aussi d’avoir dormi grâce à la véganine, il me semble que j’ai quitté ce malaise profond d’hier. Dormir était totalement nécessaire. Je vais aller marcher à pied un peu plus tard. Poster la lettre que je n’ai pas encore écrite à B.
…
Mais que je viens d’écrire. Où j’ai dit noir sur blanc que mon projet de cinéma indien était stupide. Je crois que je l’ai toujours su. Que ce n’était qu’une escroquerie intellectuelle. Quel débarras. Je vais aller poster ma lettre et marcher un peu dans le jardin, non, dans le quartier c’est effrayant ce que ça pue la pollution. Mais quel plaisir de sentir ma tête récupérée, de sentir de nouveau le soleil, le temps, d’entendre moi à l ’intérieur de moi. Le mot « piégé », le plus laid de la langue française, le seul profond et véritable haut-le-cœur que me provoquait S quand il le prononçait car il me signalait toujours que le piège était une de ses notions et pas une des miennes du tout. Au contraire de ma propre panique du piège, lui aimait à en tendre.
Et hier en fait, c’est ce que j’avais, cette panique de me demander comment, avec mon intestin délabré, j’allais tenir le coup, et donc l’idée d’être prise au piège dont je vois maintenant qu’il est ouvert. Tourné vers le dehors. Aller poster la lettre, marcher un peu dans les rues assoupies de l’heure de midi. Et cependant, quel ennui de ne pas profiter de ce jardin, de ce soleil, chaud au visage ; envie de rien de précis, sinon que le temps s’écouler, sûreté maintenant de devoir expliciter mon projet occidental. Mais sous quelle forme, c’est ce que je dois savoir.
Repenser à Maurice Olender [5]. Un texte du XXe siècle sur quoi ? Ni sur la maladie, ni sur le cinéma. Essayer comme une analyse douce du film. Essayer de dire comment le cinéma, il n’y a qu’à le regarder. Mais cela ne s’écrit pas, of course, cela se fait.
Pour un Texte du XXe siècle, peut-être jamais après tout. Mais un roman par lettres où il y aurait je ne sais quel effritement, comme une peur de dire les choses. Des lettres retenues, mais tendres, de ce que je pourrais dire à S, à F, c’est vrai celui-là, je l’avais oublié. Des lettres de douceur, mais pas à sens unique. Ils ne sont que de mauvais substituts à ne pas utiliser. J’ai envie absolument d’être amoureuse à mon retour. De n’importe qui ou quoi. Mais en réciprocité. Voir des êtres qui m’attirent vraiment, pleinement. Fondre enfin.
Page tournée. Inde où vient s’entasser ce qui n’allait pas. Poubelle en somme. Le pays s’y prête ! Un peu, jamais ou beaucoup, vaste comme le sarcophage crétois où j’avais déposé JJ avec succès. Ici, je dépose une certaine forme de moi malheureuse mais pas moi cependant, juste une idée que les autres peut-être parfois exploitent de moi. Je ne sais même pas si c’est une attitude vaincue. Oui, peut-être.
Sas de décompression, avais-je dit ? S’agit-il de décompression ? De changement de pression en tout cas. Une pression « sous pression », « sous tension » et stérile, à échanger contre un « poisson dans l’eau ». « Elle était racontable, vois-tu », c’était drôle, cette soirée d’hier avec Henri où il m’a parlé de ses amours avec N., une nana qui n’était plus là, et moi des miennes non exprimées, ni abouties, à demi imaginaire, non vraiment désirées, un effilochage qu’on arrivait à dire, sans doute pour se dire ensuite à soi-même, eh bien tu vois, notre histoire, elle était racontable, donc finie (et d’ailleurs en ce qui me concerne, pas commencée, comme une espèce d’ombre, tremblée de l’ordre du possible impossible !). Nous étions dans son salon, couchés par terre, chacun enveloppé jusqu’au nez dans une couverture car il fait froid, et buvant des litres de thé. On a parlé jusqu’à 4 heures du matin des trompe-l’œil des amours passées ou présentes, imaginaires, embellies, inexistantes ou inabouties, déceptions. De la parole perdue et éperdue (un peu sexualisée comme toute parole sur la sexualité) pour se voir soi dans l’œil, par l’œil, de l’autre. Mieux se comprendre soi-même en parlant à un autre. Mettre en forme, faire ressortir les arêtes, taire des flous qui deviennent clairs tout d’un coup. L’identité narrative, etc. J’ai adoré cette soirée, j’étais comme quelqu’un qui ferait de la spéléologie.
Réflexions sur les jours à venir. Samedi, Red Fort, oui. (Fait)
Dimanche, lundi, ?
Mardi, hôtel et Thaï [6].
Dimanche prochain, rien.
21 janvier. Annexe 21/1 [7]. Bonne Maman aurait fait remarquer que c’est l’anniversaire de la mort de Louis XVI et moi, je suis dans ce Fort Rouge passablement laid et sans intérêt, mais heureuse d’avoir une chaise occidentale et de m’asseoir au soleil et de fuir, absolument fuir, la foule de la rue, non décidément, les bazars de la différence, de l’exotisme, ce n’est pas pour moi du tout. Je n’irai pas dans Chandi Chowk [8], beurk. Je reprendrai un chaud taxi pour je ne sais encore où, et je pense que ce sera pour aller à l’hôtel Ashok ou dans quelque lieu hyper civilisé. Haine fatale de tout ce monde. Les lépreux aux feux rouges. On a tout le temps honte. Et les deux Européens rencontrés en arrivant – elle style Laura, lui style Kobus, qui jouent à la balle avec le petit môme et doivent croire « communiquer » avec l’âme enfantine indienne, c’est proprement terrible. Ce cinéma qu’on se fait en milieu jeunes baba cool. Je ne vois absolument pas comment ils ne se voient pas « autres », désolément et indubitablement « autres ». Je hais les jeux de balle, et conséquemment ces escogriffes naïfs.
Peut-être aussi, j’ai passé l’âge de me fusionner. Je suis trop définie, trop en contour d’une part et trop simple d’autre part, pour qu’il y ait encore de la place pour des cultures trop différentes [9] ? Ce serait en tous cas intenable, impensable, de passer 2 mois à Delhi. Je pense en même temps à F, qui doit se trouver dans les – 20° de Montréal.
« L’étrangéité » de Pascal Quignard [10], avec sa façon de parler précieuse et ravissante, ses romans, ses recherches sur Rome, sa passion de la viole de gambe, sa femme qui travaille aux manuscrits les plus précieux et rares de la BN. Une sorte de monde de culture du XVIIIe siècle, comme il serait étrange dans ce monde crade.
Écrire tout de même que, quand je tourne la tête, vers la gauche, la petite mosaïque rose et blanc/gris est jolie. Mais enfin, je ne suis pas sûre que cela justifie le passage à Red Fort, sorte d’exil, de tribut payé au tourisme. Indiens, des Indiens atypiques, il y a quelque chose de leurs visages misérables et brûlés , de « figure hideuse » comme dit horriblement Entremont. Il est vrai que les visages des femmes touristes ne sont pas plus réjouissants, avec leurs cheveux blanchissants, ou teints, leurs jupes, dire que je pourrais être en jupe, dieu du ciel !! Heureusement que M. m’avait prévenue, on ne montre pas ses jambes ici.
Il y a ce minuscule môme en costume de soldat entre le vert-de-gris et le kaki avec des épaulettes dorées haut comme une véritable botte, et qui offre un sac de plastique vide ramassé sur la pelouse à sa famille ravie. Tiens, les escogriffes sont partis et voici l’autre petite môme en robe rouge avec des pompons en bas. Les escogriffes ne sont pas partis. Ils « communiquent » assis par terre avec des gens, ils jouent encore à la balle, dieu de dieu ! Ils auront leur « expérience » indienne, retour home, ils dirons la chaleur du peuple indien, ouaf !
Par moments, j’ai l’impression d’être au XVIIIe siècle en voyant ces femmes en doré, rouge etc. comme sur les gravures anglaises d’autrefois. Temps comme « estourbi », pas affolé, mais sonné, ne faisant plus que des vagissements d’époques désaccordées. C’est les bonnets des mômes aussi qui font XVIIIe aussi avec ces espèces de corolles.
Je finis par rire de mon rejet. Je lis le guide de Nouvelles Frontières et à chaque ligne, je commente, « c’est complètement con », « quelle connerie ». Et en même temps, un soulagement intérieur de voir la journée s’avancer, l’exil s’écourter, l’accepter. Sentir l’odeur plutôt sympa de l’oignon frit, d’où la certitude de réussir à manger ce soir – bide un peu réparé. Je n’avais pas encore remarqué le brillant château d’eau sur le fort, ceci est drôle, joli.
L’impudence des touristes avec leurs appareils photo.
Je retrouve maintenant le grand cahier rouge, je suis rentrée chez Henri, c’est toujours le même jour, je ne fais plus qu’écrire sur moi… car je sens que je vis quelque chose de bizarre, une sorte de mue par répulsion. Comme s’il était vital que rien d’indien n’entre en moi, ce serait un poison. Écrire et regarder l’heure.
Samedi 21 janvier (suite).
Je vois que les jours ont retrouvé leur nom. Réappropriation ? Sans doute. Il faudrait que je recopie toutes les pensées, impressions, écrites à Red Fort et qui étaient véritablement du rejet (C’est ce qui précède, baptisé annexe 21/1), enfin, ce n’est pas du rejet qui est une attitude active, c’est le contraire, c’est la fermeture de moi à tout ce qui est ici, je ne sais pas comment cela peut s’appeler, comme un stade antérieur au rejet, du « barricadage » hermétiques, de la phobie. Je vais mieux, mais finalement pas bien, je refuse de voir les choses, de manger les trucs, de sentir très longtemps certaines odeurs, les moines crasseux, one roupie, one roupie, etc. désespérant de saleté et de laideur.
Il n’y a aucune séduction dans ce pays, aucune attirance physique, seulement de temps en temps des yeux assez beaux, comme le mec du rickshaw qui m’a conduite aujourd’hui, des yeux intelligents. Mais le reste, cette vilaine petite anatomie, cette pauvreté comme une gigantesque mise en scène d’autre chose, comme d’un empilage non maîtrisé d’époques jamais vues d’en haut, et pourtant si, les empire, non en fait, ils ne voyaient rien d’en haut, juste ils étaient posés dessus, espérant « les richesses » mais ne voyant sans doute qu’eux, ne voyant pas leurs possessions comme des terres et des gens, juste des connexions de rizières, et les gens, eux, toujours à l’écart de la pensée du pouvoir. Jacobine oui sans doute, mais c’est cela qui a donné aux Français de sortir du XVIIIe et où l’Inde est encore au niveau de la population. Fort Rouge, les couleurs et les silhouettes du XVIIIe : il me semble que je vis plusieurs époques, moi touriste 1990 (Tte Paulette 1930) moi tout court qui suis en train de secouer le prunier de je ne sais lesquelles de ses prunes.
Ce voyage est vraiment une « stagnation-voyage » initiatique où la stagnation (du temps, ces minutes qui sont si lentes, si régulièrement lentes sur ma montre fidèle) est en effet conforme au schéma du sas, un sas dans un sas, on ne bouge pas, on attend de se vider d’une atmosphère et que l’autre alors s’ouvre et se présente. Le retour sera-t-il cette ouverture, théoriquement, affectivement, prévisiblement, oui.
Les aigles, les vautours, les mainates, les vélos, les chevaux, les moines et un rat blanc abruti à coup de savate dans une cage de bois.
Je me demande si en fait les hippies déboussolés ne trouvaient pas ici une accélération définitive à leur déboussolage, mais je pense une quasi innocence pour certains. Le genre Petel (je ne sais plus qui c’est, en 2013 et je ne comprends donc pas du tout ce que j’ai écrit là ) devait survivre par le mythe qu‘il portait, le cinéma qu’il se faisait.
5 heures 10, une soirée encore, puis deux autres avant de cesser de jouer toute comédie et d’être enfin, à nouveau seule dans les hôtels. Mais avec la différence que ces hôtels seront confortables et que je roule sur la pente descendante et non montante du temps indien. Il roule lentement mais sûrement. Demain, je pourrais p. ex. retourner au musée, ce serait une assez bonne idée, surtout s’il y a une cafét’ et je pourrais aussi m’y reposer et mieux le voir que la dernière fois où j’y étais comme un zombie. C’était quand déjà ? Mardi ? Mercredi ? Peut-être mardi, je pense.
Le monde filmique est connecté sur le nôtre qui lui fournit les questions et les éléments, qui en reçoit des réponses provisoirement acceptables, des modèles d’explication, mais qui de ce fait les dispose avec système, comment penser correctement ce système. Je dirais mieux « des questions en forme de réponse ». Oui. Des questions qui se proposent comme des modèles de réponse possibles et peut-être ainsi constituent une « réalité » décalée.
Faire mon séminaire du 10/2 autour de ces questions,
a/ de la contextualisation et la décontextualisation.
b/ autour de l’analyse simplement visuelle des espaces/temps/personnages dont on n’a plus que la partie décalée, question réalité tradition et remaniement.
22 janvier.
Dimanche écoulé à parler. La capacité à parler avec Henri est proprement stupéfiante.
Il fait partie de ces gens avec qui j’ai 20 ans et où on explore le monde, la famille, l’enfance, et les pères, les mères, les frères, les sœurs, Pontalis, le communisme, l’archéologie, la peinture, l’ethnologie, la littérature, et le droit des peuples.
Dans 8 jours, je ne serai plus très loin de l’avion. Ce qui m’ennuie un peu, c’est que je ne verrai rien pendant ces huit heures où on foncera dans la nuit et où le soleil en effet nous rattrapera, volant plus vite que nous autour du vaste monde.
Mes petits camarades, pour parler comme Sartre, doivent se lever, commencer à se passer des coups de fil.
Cette nuit, j’ai fait beaucoup de rêves et je regrette de ne pas les avoir mieux identifiés.
Penser mon sac pour Madras : 1 veste coton noir, 3 chemisiers (rouge, blanc et fleurettes) 2 pantalons (le gris), médicaments, toilette, veste blanche peut-être. J’ai merveilleusement minci, plus de ventre du tout, l’Inde a du bon. Corps de 20 ans, presque, j’aime bien même si ça me fait un museau un peu aigu.
Henri : il me semble que je perçois un peu l’état où il est dans ses amours, état effrité d’une certaine façon, mais dont il dit voir les ruines finalement moins obsédantes, une fois faites ( moins encombrantes que prévisibles). Je me demande comment ça tournera.
Impossible de me rappeler ce que mes étudiants passent aujourd’hui comme film, pendant mon absence : Chérie, je me sens rajeunir ? Persona ? L’Ile du Dr Moreau ? Tristana ?
Généalogie, sorte de cercle dans le temps, Oui, peut-être car ils peuvent être frappés sur l’ensemble du cercle. Notion de cercle, cf Benveniste et les quatre cercles de l’appartenance sociale. Eh bien voilà, je ne le sais plus bien, c’est à vérifier à mon retour et voir comment et où se dispose le médecin ? Non, aucun intérêt. Non, ça ne va pas ces cercles, car ils ne sont pas forcément autour du héros, ou plutôt le malade est-il forcément le héros ? Si, il l’est puisque je le dispose comme tel…
Si je devais faire un bouquin, ce serait peut-être comme un voyage autour de ma chambre, une série de lettres écrites par les institutrices des Basses-Alpes mariées au Mexique, mais tout fascinant que cela soit, il faut reconnaître que c’est complètement passéiste, trouver l’équivalent maintenant sans tomber dans l’exotisme, car le but est justement de dépeindre ce transfert fou d’un univers perdu qu’on ne veut pas savoir perdu ou plutôt être transférée dans un univers dont on ne veut rien savoir puisqu’il montrerait en se montrant que l’entourage du premier est perdu et qu’on est donc en fait dans le vide, c’est le vertige absolu, et ça s’appellerait J’ai pas le vertige. Et ça serait l’histoire d’un vertige fou, social, humain, l’idée de la mouche sur une aile d’avion : elle se dit « merde, ne regardons pas en bas », elle se cache derrière un écrou, par chance elle ne meurt pas de froid et quand elle arrive enfin en bas, elle est en Chine peut-être accueillie par les fly tox des campagnes anti mouches maoïstes ou en Inde avec trop de concurrence. Ou bien elle est Bd Blanqui où il se passe quoi ? Elle rencontre une autre mouche ? Elle se glisse dans la salle de bains et elle boit l’eau des plantes ? Le mieux serait certes de raconter une mouche.
Problème d’identité sexuelle de ladite mouche, féminine, de même l’héroïne de J’ai pas le vertige. Mais elle aura peut-être connu Yves Portier. Ce pourrait être une personne d’Argenteuil [11]. Ni Céline, ni Julia, ni Camille ni Lili, ni la mère, peut-être Juliette à Berlin.
Inviter Henri et Silvia à dîner dans le restau pas loin de la maison. (c’est fait).
C’est drôle de me retrouver dans cette ville d’où je ne rêve que de fuir, pour entendre parler de Martin V. que j’ai connu il y a vingt-cinq ans. Cela me renvoie à 1965 : à la mort d’Olivier, Martin m’avait proposé d’habiter chez lui pour fuir la rue Frémicourt et tout le cadre de ce malheur si profond, si désespéré, paraissant si infini. J’étais un animal presque mort avec encore juste un cerveau qui me ferait savoir que je souffre. Mais Claude, Jacques et moi n’avions pas quitté la rue Frémicourt.
Pour N. et H, je comprends N. Enfin, je ne sais pas. Moi, maintenant je sais trop bien que amor de lejos, amor de conejos, comme m’avait dit le curé de Jalapa, dans la chaude soirée de décembre sous les jaracandas à attendre je ne sais qui, on bavardait dans ce Mexique d’où j’avais aussi hâte de me tirer pour rejoindre JP. Et comme il en savait long, le curé de Jalapa, était-ce d’expérience ? Il avait l’air sorti d’un film de Buñuel. Ou bien n’était- ce qu’un proverbe pour lui, ou bien un souvenir d’une connaissance à lui ? Oui, Delhi est invivable, Henri ne s’en rend sans doute pas du tout compte, car il aime ce pays, que faisait N. dans cette maison toute la journée où il n’y a rien à faire, proprement rien, puisqu’il y a G., l’efficace Indien.
Plus je vais bien, plus j’écris ; quelque chose s’est comme dénoué dans cette journée de mercredi, où j’ai fait la seule chose à faire, me ramasser en boule. Puis recommencer à fonctionner. Certainement, et sans le savoir, Henri m’a sauvé la vie. Je n’aurais pas tenu le coup. Peut-être serais-je allée à l’Ashok, oui, c’était une solution mais coûteuse. Sinon il aurait fallu payer un billet d’avion pour rentrer en France, hors date de mon billet de la Thaï aux dates bloquées. Je mourais. Deux visions de l’enfer : la chambre 404 de l’International Inn (ce nom, pour ce bouge !) et la Grande mosquée devant Red Fort, cette espèce de monument avec son dôme comme en zinc, avec cette foule serrée, atroce, circulant devant, yeux qu’on ne peut pas rencontrer, à fuir absolument. N’avoir vu de Old Delhi que l’horreur. Je suis un peu curieuse de Madras, que j’imagine finalement mal, trop comme un port européen et je ne suis pas sûre de mon bien-être à l’hôtel, avec larbins, pistache et tout. Mais tout vaut mieux que de renouveler l’expérience de l’hôtel cheap.
En rentrant à Paris, je laisserai ce cahier rouge et je devrai choisir un nouveau cahier pour ce qui sera l’après [12]. Après beaucoup de choses. En fait, c’est ce cahier rouge qui pourra s’intituler J’ai pas le vertige, car c’est exactement ce thème, mais non sur un mode romanesque, bien au contraire, le thème comme démasqué alors qu’un roman le masquerait.
Une fois la nuit passée, 7 jours resteront à « dégueuler » ce pays, encore, dormir, me réveiller, redormir, valises, brouhaha après ce grand calme de chez Henri et en même temps, silence après tant de paroles chaudes et vivantes. Quel curieux séjour. Venir si loin pour voir que je n’ai rien à y faire, que je ne peux pas y vivre, venir apprendre à regarder ma montre, compter les heures, compter les jours, raconter des bouts de ma vie à Henri si chaleureux et écouter des bouts de la sienne, qui se font écho ou s’emboîtent par moments, comme des roues dentées ou filent en parallèle. Car tous deux, à 20 ans d’écart plus ou moins, nous sommes devant une perplexité, un ajustement relationnel, un examen obligé de manière de vivre.
Dans mon boulot, rester au plan purement formel n’a aucun intérêt. Car c’est bien complètement mon propos général qui montre la circulation des éléments visibles et invisibles. En restant au plan formel, j’élimine, je me prive de cette construction tierce entre visible et invisible et qui est la construction proprement filmique. Oui. Donc, impossible ou plutôt inutile de chercher si la comparaison est faisable, car le visible et l’invisible étant différents, le résultat tierce est forcément différent ; or l’invisible l’est très certainement (c’est un monde autre), le visible l’est de façon éclatante. Le projet de travail sur un corpus oriental est donc à abandonner complètement.
La capacité de parler d’Henri est quand même un problème, car après avoir parlé sept heures de suite avec moi, il a eu juste un break d’une heure, et hop, le voilà reparti avec Silvia sur leur boulot. Increvable Henri.
En définitive, j’aurai quand même eu quelques idées exploitables (dans le boulot)
– l’idée de l’objet perdu (pour les maladies) et des cercles qui se précisent
– de la contextualisation
– la démonstrativité contre l’allusivité.
Lundi 23 janvier
Écrire mon mode d’emploi de Delhi : ne surtout pas voir « le peuple ». Bravo, madame l’intello de gauche. J’atteins un comble de dédain et de peur profonde, « aux Indes », me réjouissant d’aller s’enfermer au Taj de Madras. Et me gargariser du temps qui passe, des jours qui s’écoulent et franchissent à tour de rôle le tourniquet du présent vers le passé, prêt (le tourniquet) à happer un nouveau jour, une nouvelle nuit, puis certitude de pouvoir en sortir, mais en étant relativement épuisée.
Hier, en allant au restaurant, lieu agréable, quelle désagréable ruelle sale aux odeurs puantes. XVIIIe siècle complètement obsédant et malencontreux. Une certaine excitation aussi à ce que le temps passe et que le vrai compte à rebours soit commencé, de la dernière semaine. J’aurai tout de même été dans un drôle de sas, je l’imaginais bien en tant que sas, mais je ne pouvais pas quand même imaginer qu’il y aurait un côté si insupportable, si infernal ou plutôt une réduction du sas à moi-même, objet-bulle à préserver à tout prix, tout à fait ocnophile, mais l’objet de survie était moi même, Henri ayant été un relais transitionnel incomparable, incommensurable, indispensable, vital.
En somme, j’avais devant ces trois semaines une certaine disponibilité et je n’ai pas vraiment cherché d’autre guide que mon flair, qui m’a dit quand je devais arrêter sous peine de détérioration grave de mon état mental. Cette attitude imprévue m’a permis de sortir du schéma prévu : 15 jours de films, 8 jours de tourisme car et les films et le tourisme m’ont fait assez rapidement défaut, en même temps, je pense.
Si bien que je me suis retrouvée effectivement désemparée, complètement désespérée, occupée uniquement à me protéger des « autres » et à compter combien de temps il fallait survivre dans cet état d’apesanteur (ni travail, ni justification possible) dans ce constat de mon désagrément.
Plus je me suis mise à m’avouer ce désagrément, moins j’ai pu le supporter, au point que j’en suis là, assez bien et voyant en effet que l’ « initiation », « le voyage initiatique », pour se dérouler différemment du prévu, n’en était pas moins une vraie initiation ou plutôt une sorte de « retraite ».
Projet peut-être pour Olender sur le vertige. La perte symbolique de mes lunettes, à l’arrivée, à l’aéroport, en remplissant la fiche de débarquement : ne plus pouvoir voir. C’est exactement ça, et pourtant j’ai vu, et je n’ai pas aimé ce que je voyais.
En fait, il faudrait peut-être maintenant retourner le gant, c’est-à-dire trouver du plaisir, me détendre, au lieu de me retrancher. Me dire que les choses sont faciles. Les non compréhensions, on peut passer par-dessus, elles ne durent pas toujours. Demander à parler plus longtemps, plus lentement, et finalement comprendre. Ne pas s’affoler, profiter de l’environnement probablement aisé de Madras pour achever cette (méta)morphose, cette morphose tout court. Mais il n’empêche que je ne dois pas non plus faire trop de projets et de simulation sur Madras, que je n’envisage tout de même qu’à travers le double filtre de Delhi et de l’Ashok et des photos de Michel Combe,. des photos de son voyage archéologique, très sérieuses et bien cadrées, un peu ennuyeuses, c’est-à-dire pas grand-chose. Pour les grands hôtels, j’ai l’expérience de l’Ashok et de celui où on était allés dîner le premier dimanche avec les amis d’Henri. (Note en marge : J’ai aussi dans la tête la chanson de Joséphine Baker que Maman chantait si bien, Adieu foulard, adieu madras (et j’y voyais des turbans noués avec des carreaux), faisant une sorte de pâté entre les Antilles et les comptoirs de l’Inde, une nonchalance)
Ce soir, foie gras et sancerre, complètement drôle.
Toutes ces femmes empaquetées, c’est assez monstrueux, complètement même. Henri a raison, le contraste avec les rues italiennes avec les jolies femmes rencontrées qui se montrent aux yeux des autres sans façon, et les rues indiennes où toutes sont des paquets (avec parfois de jolis visages et de même de si jolies couleurs) est étonnant.
Mouche sur surface.
Panique superbe devant le paysage d’enfer de la mosquée, cette extraordinaire vision animée et prête à me dévorer.
Oui, il y a peut-être ici, mis en scène dans la laideur et l’absurde, le pétrifiant non-sens de l’être humain que tout l’Occident, depuis Mycènes, s’acharne à contrer.
Les gestes des Himalayens témoignent bien sûr de la valeur personnelle du récitant à l’égard des autres de sa société (surtout), à l’égard des dieux et des ancêtres, de ses dieux et de ses ancêtres.
Le cinéma livre-t-il plus qu’une quête d’identité de soi, une quête, une description de soi par rapport au passé, au temps passé, aidé par la forme même d’écoulement du film ; qui inscrit cette quête dans un sens. Oui j’ai grâce à lui un argument excellent contre la sémiotique qui, se livrant au pur exercice de souligner, dégager, construire le sens, laisse de côté la validité de ce sens dans la société où ils sont présentés. Présentés ou utilisés, poétiques ou utiles. Le succès populaire du cinéma en montre la nécessité. Ce n’est pas un divertissement pour lettré. C’est d’ailleurs pourquoi mon projet sur le cinéma indien est de l’ineptie pure, car, en effet, je ne pourrais faire que la « sémiotique » du film indien, sans avoir les outils nécessaires sensibles et de connaissance intime, sans cette circulation avec l’univers mental acquis au jour le jour dès la naissance, exactement le contraire de ce que je fais. Il a fallu que je vienne ici, si loin, et de lire ce petit bout de compte-rendu de Henri (2013 je ne sais quel compte rendu - lu où et à quel sujet - j’évoquais ? ) pour m’en rendre compte : ça c’est mon cours du 10.
Ce que c’est dur à respirer quand même, en Inde, la naphtaline, la rose, l’encens, l’aéroport et le gaz brûlé, la poussière, l’égout bouché, l’Inde tout entière pue et je vais jeter mes rideaux indiens dès mon retour, je les haïssais bien avant de connaître ce bain d’odeur et je vais m’acheter des rideaux blancs illico. Restera la question du divan ? Ou plus rose pour le tapis ? Je ne sais pas, mais ce sera mon prochain engagement. Avec les rideaux de ma chambre aussi..
Lenteur, quelle lenteur tout à coup. Mais ici sans douceur, sauf seule dans ce jardin ou à parler avec Henri. Ongles devenus cassants. Muqueuse de mon nez en sang (poussière et pollution) Cheveux séchés au soleil. Pull noir à torsades et côtes très agréable, montant bien.
3 heures 20. Le soleil va me laisser dans le jardin et je pense que je devrai lire un peu Baudrillart pour me reposer. Me reposer de quoi, je me demande. Je ne fais RIEN depuis une heure et demie, j’ai lu L’Évènement du Jeudi et j’ai un peu pensé à mes cours.
L’homme brun est à nouveau sur la pelouse en train de désherber, on ne sait sur quels principes et à ramasser les feuilles suivant la technique de Mme Picco lorsqu’elle disait « faire » le couloir de l’École, en fait en ramassant avec deux doigts une ou deux grosses poussières.
Madeleine Biardeau en Inde, Charles Malamoud [13] en Inde, sortes de génies abstraits et fascinants, disposant choses et êtres dans leurs grillages conceptuels. Ou est-ce moi qui suis invraisemblable dans mes rapports avec ce pays assourdissant, abrutissant et irritant, puant, énorme,écrasé, écrasant, lourd, trop lourd.
J’aime bien maintenant cette activité de tenir un journal, ce ressassement où je n’ai qu’à laisser le ressassement épuiser l’inquiétude, anticiper, alors même que l’anticipation est impossible, car les évènements se disposent à leur rythme.
Quand je pense que je disais « je n’aurai pas le temps (d’aller à Agra, sommet du tourisme banal, de visiter telle chose) » alors que le temps est inépuisable et que je le passe à le regarder passer, à le subir physiquement par le mouvement du soleil, par les chiffres romains de ma montre, dans l’écartement du rideau ce matin, dans l’évolution de la pénombre de ma chambre ou de la grande pièce, où nous passons nos nuits à bavarder dans nos couvertures.
Le mieux a tout de même été l’après-midi à Red Fort, une sorte de sommet de l’anti- tourisme, une élaboration précieuse et rare de la manière de (ne pas) être touriste. Là, je m’adore. J’estime que j’ai très bien mené ma barque, comme disait Papa. Oui, on mène toujours bien sa barque tant qu’elle ne se remplit pas d’eau par le fond.
Les vautours inlassables dans le ciel bleu, la pelouse, le palmier, le manguier et cette sorte d’acacia à moitié mal feuillu, avec une certaine grâce dans les branches. Au premier plan, les colonnes de soutènement de la terrasse. Les mosquées d’Afrique du Nord si belles et blanches à côté de celles-ci tarabiscotées et violentes, hérissées et gris métalliques, mille et une ruines toujours un peu pacotilles, le claustrat bleu en plâtre, le petit mimosa au milieu des ruines, les marguerites.
Après avoir tant rien fait que lire, rêvasser, regardé les vautours, quel plaisir ce sera, en rentrant, de faire, d’avoir à faire ; en fait, on est, on existe par ses actes. On n’est pas tellement, sinon. Sans action, on est juste en survie.
Une grande crise de mélancolie ou de phobie permet de jauger les non-raisons de la crise, ou ses raisons (objectives) je ne sais pas, mais je vois que en effet, elle s’est dissoute dans l’ennui et l’éloignement. Il y a quinze jours j’étais à Roissy, Roissy, c’est laid à mourir et cet engluement (quinze heures de retard, qui s’étaient accumulés à partir d’une heure officiellement annoncée et qui s’allongeait toujours) était déjà plein de préfigurations. Les circuits électriques de l’avion n’étaient pas en état et faisaient de la résistance.
Peut-être l’ébranlement est-il plus profond, une remise en cause, et à neuf, encore plus grande que la cassure nette du segment terminé. Il a quelque chose qui me le fait pressentir dès avant le départ il est vrai, et plus encore ce soir, dans cette sorte de mélancolie née du ratage de ce séjour sur le plan contact avec les films.
Le soir tombe sur la maison d’Henri et sur l’être presque minéral que je me sens - minéral et solide comme un noyau extrême. Voir mes limites, touchées, atteintes. C’est vrai, seule la solitude est évolutive, en rapide, sinon, avec les autres on évolue aussi mais avec eux c’est plus facile : on ne surveille pas, on ne s’épie pas, et on ne voit qu’après, un peu flous, les mouvements survenus. Ici, les mouvements suivis à la minute sont des failles, des fractures repérées, « pulsées », acquises ensuite.
J’ai vraiment hâte de finir cette retraite, et de pouvoir enfin, le cœur libre et léger, repartir à zéro, comme Édith Piaf - ou Michel de Certeau. Les vautours ne volent plus, les gros oiseaux gris noir s’excitent dans un gros arbre au loin, et des gracieux oiseaux à fine queue crient dans le jardin . Chute du jour. Je joue à préparer ma valise. J’ai assez hâte d’être à après-demain pour raison de repos loin de Delhi et de ses complications, de ses merdes. La chance de ma vie : d’avoir déboulé chez Henri, le jeudi 12 à 10 heures du mat’.
Plus le temps passe, plus je me sens étrangère à l’Inde, à cette ville, en tout cas, et finalement c’est normal, car le compte à rebours ayant vraiment commencé, le Zéro du départ m’attire, me convainc que je vais m’en aller et que donc je n’ai rien, mais rien à faire ici et surtout pas besoin de travailler à m’y faire.
Demain, je quitterai la maison vers 1 heure, j’aurai ainsi le profit du jardin dans le soleil du matin, ne pas arriver avant 1 heure à l’hôtel Plaza, bouffer ici à midi et puis aller à la Thaï [14], cool, et puis rentrer à l’hôtel, regarder la télé, téléphoner pour me faire réveiller et pour appeler un taxi, puis dîner. Car demain soir, je ne serai dans ce jardin, ni dans cette maison. Henri sera parti, lui aussi. La maison sera vide. Elle gardera nos paroles, les rangera. Henri sera parti vers le nord, moi au sud à Madras. On ne se verra pas lorsque je repasserai, car il est parti pour plus longtemps que ça. Bizarre. Je me récite ce que je ferai demain, et demain, il faudra le faire. Me changer pour aller dîner avec Henri et les autres.
Mardi 24 janvier.
Les jours sont quand même assez lents. Et pourtant, ils tiennent presque sur les doigts d’une main. Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche, une main et un demi-doigt. C’est vraiment long, j’en ai vraiment marre, de ce sas qui commence à perdre même son intérêt fascinatoire.
Je n’irai pas à l’Ambassade. Ça me barbe. Ça me détourne.
La soirée d’hier, en revanche, était très agréable. Les amis d’Henri sont vraiment très gentils. Henri aussi, d’une qualité vraiment tout à fait rare. Dans la nuit j’ai rêvé à lui, il avait son pull bleu, il était comme un vrai nounours transitionnel. Nous ne faisions rien d’autre que d’être ensemble et de nous sentir très bien. C’était doux et tellement vrai, ce rêve.
J’ai le cerveau comme de l’eau : je lis une masse de choses de la bibliothèque d’Henri sans rien retenir du tout, un peu comme un mois d’août.
A la faveur du temps, du sas, de tout, ma relation avec S est en voie de relégation, je me demande s’il n’est pas rangé à sa juste place, qu’il n’aurait jamais dû quitter, un ami perdu de vue.
Ce matin, dans la petite rue, la mendiante à la Duras (dans Calcutta etc.) se lamentait avec ce « Lalèh » plaintif, une bande-son sinistre. La ramasseuse d’ordures et son balai disperseur était aussi lugubre. Quel pays sinistre. Écrabouillé. Ils n’en sortiront jamais.
Je ne serai pas le Dumézil du cinéma indien, ce qui me fait sourire. Mais je dois pouvoir articuler les problèmes vie/mort, sexe/temps/ avec les éléments où ils sont le plus sensibles ( ?? 2013 ??)/
(Suit une longue série de tableaux très schématiques, elliptiques et confus à la fois pour me permettre de penser les éléments de mon séminaire, sur la maladie, le couple et les généalogies. Je ne recopie pas ces passages incompréhensibles, insuffisamment développés, mais qui ont donné de l’élan à ce que j’ai pensé par la suite, en rentrant, dans mon système d’analyse de films. Il y avait donc une reprise de pensée abstraite, une amélioration de mon état).
Non, c’est évident que je n’irai pas à l’Ambassade, je me ferai élégante au Taj, pour moi, pas pour ce minuscule ghetto culturel très prétentieux. Même pour Depardieu [15].
Je m’aperçois que finalement j’ai assez bien bossé sur le cinéma, et que, sur le plan boulot, j’ai fait machine arrière de l’impasse indienne et réussi à retrouver à peu près le rail, mes « concepts », ce serait peut-être un grand mot, mais sur le plan organisationnel à parfaire ou développer. Bouffe/sexe/métaphorique et métonymique/ allégorie. Approcher le mythe par l’allégorie ?
Quand par hasard le bruit s’arrête, dans ce jardin, c’est tout bonnement le paradis. Mais ce n’est pas long, je ne sais si ce sont les rickshaws ou les bus les pires. Seuls les vélos et les chevaux ont de la grâce. Ce pays « organise » son espace en le remplissant, en le bourrant, en le saturant.
Je voudrais qu’Henri rentre car pour une fois, je voudrais sortir. Je voudrais bouger, faire bouger.
Thaï, Thaï, Thaï, en fond sonore, il vient de la rue, une musique plutôt arabe, tout à fait laide aussi. Je ne rapporterai rien à la petite Petel, hormis ses graines ruineuses de cardamome. Aucune cassette de merde, ni de Bouddhas hideux à C. Certes pas, je ne vais tout de même pas me charger de conneries pour m’enquiquiner deux fois, à les choisir et à les transporter.
12 A, Connaught Place, Thaï, si je n’ai pas le temps d’y aller aujourd’hui, prier le Taj de le faire pour moi. Ils l’avaient fait pour JJ et moi dans ce bel hôtel au Maroc, et en Sicile à Palerme.
Cinéma : je dois raisonner aussi sur les situations de guerre/maladie. Où il y a pareillement vie et mort. Oui, il y a vraiment du positif dans cette pensée sur le boulot, déterminé par le négatif de l’impasse indienne, le mur indien où renvoyer ma balle. Et ici, au piège du temps bloqué, je ne peux fuir un « avant » comme un aimable papillon, comme je fais à Paris où il y a toujours plus court, plus pressé, plus drôle à faire qu’à réfléchir sur des situations désagréables ou difficiles. Ici, bloquée, je réfléchis sur du bloqué (boulot ou relations). Comme quoi, c’est en parlant avec Henri de sa mère que vient mon boulot d’aujourd’hui (sur la page en face, des tableaux relatifs à Tristana [16] sur maladie, les parents, la généalogie, qui fonctionnent assez bien). Ca vient toujours d’où on n’attend pas.
Penser :
– à la lenteur d’octobre, non de décembre.
– à la catharsis indienne qui commence vraiment à m’exciter maintenant, comme une espèce de délivrance
– et à la douceur, non, je ne crois pas que le compte à rebours sera doux, dans le sens « mou », non, il sera efficace, je le crois du moins.
J’irai peut-être demain chez Jeannine lui porter le paquet que je traîne depuis Paris, c’est pas impossible, pas certain cependant. La vie me revient peu à peu, j’ai même sauté de joie ce matin dans la salle de bains, parce que je prends conscience que tout ça tire à sa fin. Le temple au bord de la mer en prime, des éléphants de pierre en prime. Vivement demain, vivement demain à cette heure-ci et pour un moment, qui sera posé, prévisible.
J’allais dire que l’homme du jardin ne venait pas le mardi, mais c’est faux, il arrive. 4 h heures moins dix, et Henri n’est toujours pas là. Je ne puis cependant m’en aller puisque cela m’obligerait à revenir (question de clé) et aller à l’Ambassade. Marre d’attendre, mais marre à un point incroyable car je n’aurai pas fait ce que je voulais faire, aller à la Thaï.
La capacité de réflexions en voyant le chien, un oiseau, une feuille, est très remarquable. Mais j‘enrage quand même. Oui, si je fais le tableau précédent, j’arriverai à localiser le mal et le malade par rapport à son espace. Mais ferais-je plus que ce que je vois avec mes bons yeux expérimentés et mon bon flair ?
Terre mouillée qui sent exactement comme le petit récipient du gâteau de l’autre soir qui était si curieux et exotique, plaisant, le plus plaisant de toute cette bouffe. Exaltation qui retombe mais bien-être qui demeure, je crois, d’avoir saisi que ça atteignait les meilleurs bords du sablier.
Henri mène une relative vie de nabab, son serviteur, son jardinier, un peu comme j’étais au Mexique moi-même il y a trente ans avec ma cuisinière, mon bel appartement, la vie assez aisée des expatriés bâtie sur la pauvreté des locaux.
Grrr ! 5 heures.
C’est vrai que mon contentement de boulot s’est raplati, mais je pense tout de même avoir progressé.
Il n’y a pas de place pour une écriture de roman. Peut-être parce que je suis trop occupée à colmater des ouvertures, à veiller aux échauguettes, pour une promenade dans un imaginaire sans contenu pour le moment, tout occupé et mobilisé qu’il est à surveiller le réel et l’empêcher de passer. Car il serait très funeste. À Paris, quand j’ai écrit, c’était pourtant aussi une réalité que je fuyais (la fuite des autres) mais sans avoir à veiller sur le reste du front. On ne peut sûrement pas, je ne peux sûrement pas écrire à l’étranger, la Crète en avait fourni l’exemple. Au Mexique, comme ici, je n’avais écrit que sur moi et encore seulement quand je m’étais sentie chez moi. Tout de même ma différence d’attitude ne provient pas que de moi (20 ans/50 ans, et 3 semaines/3 ans) cela vient du dehors, du contexte (non brutal du tout au Mexique). Ce toit tranquille où marchent des colombes, oh non, vautours, cris aigus des klacksons. Une certaine absurdité de Madras, sinon de tuer le temps. Je n’ai jamais eu tant à tuer le temps, ni si constamment, ni si fort, ça fait sept jours exactement que je tue le temps et que je ne vais plus au cinéma ou presque. C’est tout de même très curieux.
3. Madras
Mercredi 25 janvier.
Vu et dit au revoir à Henri hier.
Je vole vers Hyderabad. Cette phrase-là tient du conte de fées, tapis volant vers les trésors de Golconde. Je meurs de sommeil, je n’ai pratiquement pas dormi cette nuit. Quel soulagement ce sera d’être ce soir au lit, très tôt, dans le confort. Je vois se lever un énorme soleil rouge à l’Est.
Dans l’avion, j’ai parlé avec une nana française enthousiaste qui va à un Festival de musique indienne. Elle est folle de ce pays. Comme les gens qui ont une case mystique qui me fait totalement défaut. Et comme tous les gens qui en sont fous, elle n’a pas l’air de le voir tel que je le vois. C’est comme les bonshommes des baromètres d’autrefois.
Estomac et foie, arrêtez de vous fâcher, digérez ce qu’on vous donnera d’ici dimanche, sans plus d’histoire, SVP. « Curtain rings down on the Film Festival » c’est ce que je lis dans le journal du mec de devant. Oh oui, oui, pour tomber, il est tombé.
À mon avis, le plus dur des obstacles est franchi, c’était d’aller à 5 heures du mat’ prendre l’avion pour Madras, avec un chauffeur qui dort au volant.
Un os inattendu : ne pas pouvoir rester trois nuits dans cette chambre paradisiaque, grande, claire, climatisée, avec fleurs et fruits dans une corbeille [17]. Je crève de chaud. Fièvre ? Non je ne crois pas, juste chaud après tant de froid contraint à Delhi. Et j’ai un coup de soleil sur la gueule. Je pense devoir m’élancer devoir régler l’histoire de la Thaï, point lumineux et final, obsédant, de cet étrange voyage (perte des lunettes, bouquin de Pontalis). Avalé un Aspegic à toutes fins utiles mais je crois en pure perte, si ma crève est souci digestif ? Tenir encore le coup en grignotant ceci, cela, de temps en temps, un moment et puis voilà. Et dormi, car je n’ai pas fermé l’œil cette nuit, sauf le temps de faire un rêve. Et de m’enfermer hier soir, oh là là, le verrou s’est bloqué et refusait de s’ouvrir en coulissant, j’ai dû appeler le mec de l’hôtel par téléphone, venu le débloquer avec un tournevis ! que d’aventures en 24 heures après tant de stagnation. À l’hôtel, la peur de ma vie, et cette nuit aussi avec le taxi qui dormait et roulait à droite (donc à contre voie).
En venant de l’aéroport, avant d’arriver dans ma chambre au Taj Coromandel, sur ce beau balcon, j’ai vu des femmes sur un chantier de construction, avec leur panier sur la tête, allant et venant comme dans un film italien de l’après-guerre.
Madras est vraiment intéressant, Delhi est vraiment une horreur, la ville est « européenne » peut-être, mais quelle douceur, ici dans le Sud, réelle. L’enfer de Delhi, ses pauvres effrayants et si sales et crochus. Je continue ma crise de racisme anti-Delhi. De racisme tout court, hélas. J’en suis consciente. Mais ici ? Pas le même style. Madras est incontestablement meilleure comme atmosphère. Plus cool même, semble-t-il, sur le plan de l’épouvantable circulation, les gens moins ratatinés, moins pointus, moins sombres. Les pauvres sont mieux quand ils n’ont pas froid. On a moins honte.
J’aurai vraiment vécu mon séjour en trois morceaux, 1/ Le Festival, 2/ Henri, 3/Madras.
Madras est très bien. Et m’évoque davantage l’aimable Mexique, avec la chaleur et le beau temps chaud qui change tout. Et puis, il y a l’Océan Indien, les bateaux blancs dans le golfe du Bengale, des milliers d’échoppes, beaucoup moins de mendiants, moins de stress (sauf au volant, si, finalement là, aussi). J’ai drôlement bien fait de faire la touriste de base en prenant un bus Sightseeing, on a jeté un oeil aux musées, à toute pompe, le Zoo avec des serpents (dont les très minces, verts comme des lianes), les tortues complètement énormes et préhistoriques, de même qu les iguanes, les constructions en cours, dans leur corset de bois mince où courent les ouvriers, blancheur des crépis, rouge de certaines maisons, couleurs, l’odeur puante du bras de mer, une vieille fabriquait ses bouses en galette, à la main, au bord du canal. Et le plus saisissant sans doute était l’enterrement du vieux, croisé en allant au temple de Shiva, le cadavre avec ses lunettes, dans un vêtement blanc un peu drapé, genre Gandhi, recouvert à mi-corps d’œillets d’Inde orange, posé sur un brancard couvert d’un très épais lit fait d’autres œillets d’Inde, tout le monde lançant des pétales de rose, l’odeur merveilleuse des bouquets de fleurs près du temple, et la gêne absolue d’être de trop dans ce temple, touriste sans croyance et sans larme.
C’est vrai que leurs productions TV sont d’une débilité totale ainsi hier au Hans Plaza, l’espèce de comédie avec le « fou » sexuel qui pleurait sans arrêt entre deux crises d’ hystérie et de fureur sexuelle. Côté sexe, ils en tiennent un rayon, dans la dénégation, l’eau de rose et la violence. Pauvres femmes.
Là, je regarde des clips à mourir d’ennui : je suis vraiment convaincue que l’Inde est à proscrire absolument (cinéma) pour incompatibilité d’humeur.
Les superbes petites maisons dans les vieux quartiers, avec leur façade coloniales, pour moi portugaises, mais je ne sais pas trop, me faisaient mieux comprendre ce matin l’attirance des hippies pour ce pays, mais tout de même, Delhi reste l’enfer dans son entre-deux brutal et européen, sale et méchant. C’était très utile cet après midi, la promenade, la bonne femme du Musée Guimet, le couple belge, les deux Australiennes très agréables, avec qui j’ai parlé, en parcourant le Musée de Madras, de Jeunes docteurs pour la vie [18] !
Comme c’est bien de bouffer, ces crevettes étaient géniales, la soupe aussi, mon estomac enfin joyeux acceptera même peut-être une 2e banane tout à l’heure. J’ai mangé comme une personne normale. Sans angoisse. Sans dégoût. Sans sentir tout mon intérieur agressé comme les quinze derniers jours. Profité du pur acte de manger des crevettes au sésame un soir de janvier, comme ça.
Charmante langue tamoule, charmante écriture, charmant Madras, ces tonnes de petites maisons à colonnes et à balcons, de couleurs incroyables. Le car nous a emmenés visiter aussi ce temple incroyable, étroite pyramide tronquée, très élevée, avec la cruauté et l’entassement des dieux et des fidèles également pressés, serrés, colorés, grimaçants, mort permanente et avide qui guette celui qui tombe. Beurk ! « les dieux hindous ne sont pas les meilleurs » [19].
Je me suis renseignée sur Mahâbalipuram, pas de quoi y rester deux jours [20]. Un suffira. J’y vais demain.
Jeudi 26 janvier.
Retour plus rapide encore que prévu de Mahâbalipuram. Je dois être impropre au tourisme. Les temples ont effectivement de la gueule mais enfin, bon, en deux heures, j’en ai fait le tour. Cette religion ne me touche pas, je n’ai pas envie de l’approfondir. J’ai eu un beaucoup plus grand plaisir au paysage, la tentation d’aller sur la plage et d’y rester, mais il faisait vraiment très chaud et j’aurais craint un coup de soleil, voire une insolation, car déjà, en remontant vers ce bordel de temple, et le vertige des marches aidant, je trouvais cela dur.
Golfe du Bengale. Les paysages mourant de languidité, avec les lagunes, les maisons comme usées de leur propre charme, très Duras, très Marin de Gibraltar. Protégée par les vêtements liés à « ma bande » - le pantalon de Noirmoutier, la chemise haïtienne de Laurent – je figurerai désormais sur les 3 photos prise sur la plage par les jeunes gens genre Adidas du Tamil Nadu [21], qui plus tard, se demanderont ce que pouvait bien foutre cette bonne femme exotique et ses cheveux rouges sur les photos de leurs commodes à ancêtres et à dieux, et ce qu’elle est devenue, ce que nul ne saura dire. Ils m’ont offert de l’eau de noix de coco délicieuse.
Les différentes pastilles au milieu du front, c’est Vishnu, le blanc frotté en large, c’est Shiva. Marquage.
Tout serait très bien si on était vendredi, mais on est jeudi. Toujours ce temps qui se traîne.
Je suis dans la partie super-verte de la ville. À mes pieds, s’étendent des kilomètres carrés de palmiers et d’autres arbres. C’est un paysage de « colonies », dans leur magie, tout à fait comme celui où j’imaginais Papa, autrefois, quand on me disait « ton père est aux colonies ». Cette atmosphère alanguie, douce, soft à mourir, me fait irrésistiblement penser aux Portier de Cuba et même d’Argenteuil [22]. Beurk.
Il y a quinze jours, je vivais un des pires moments du Festival, j’étais encore bourrée de surmoi et je n’avais nulle place agréable au monde où aller. Essayer de me combiner The Beach, essayer de tremper mes pieds dans l’Océan Indien et manger du poisson là-bas.
Quel ré-apprentissage que celui de manger : aujourd’hui, j’ai déjeuné à l’heure de midi pour la première fois depuis quinze jours !! J’ai bouffé confortablement quand j’y pense : au petit déj, deux œufs, 2 petits pains en revenant à midi, le buffet à midi. La quantité de mes « problèmes » s’amenuise dans le luxe.
Les maisons sont embellies par l’air marin qui adoucit et use inégalement les couleurs vives.
Je revois les matins froids de Delhi, le vertige de la fatigue et l’intérieur ravagé par mon incapacité à ingérer ou digérer, la difficulté à sortir de mes couvertures, la douche à l’eau froide de chez Henri, l’air compassé de G qui disposait mon petit déjeuner. Il y a huit jours, je chiais littéralement l’Inde du Nord, et aujourd’hui, j’avale réellement l’Inde du Sud.
En fait, quand on regarde la rue, ils conduisent vraiment à droite et à gauche (comme la Seine). Ici, c’est plus soft, ils conduisent toujours à droite et à gauche mais ils acceptent l’idée de pouvoir s’arrêter, à Delhi, c’est je passe et crève (je crève ou tu crèves). Les troupeaux dans les prés salés de plus en plus petits, les gros buffles, quelques uns plus petits ou leurs veaux. C’était très joli. Et aussi les petits enfants des écoles dans les cours de récré, vers 8 heures et demie, bien lissés, en beige les petits garçons, en bleu marine, les petites filles. Quelle drôle de manière ils ont de prendre les routes goudronnées comme aire pour que les véhicules, cars, motos, charrettes, bus, en passant dessus, battent les gerbes de riz. Après quoi, ils balayent et ramassent les grains et la poussière.
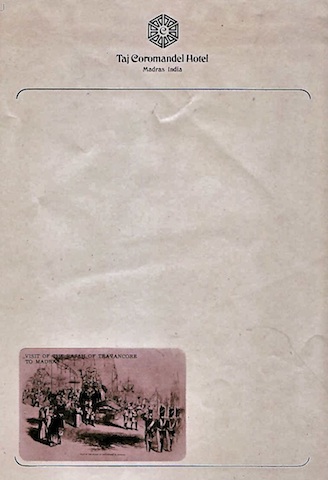
J’ai arrangé ma journée de demain, en vieille Anglaise riche, voiture à midi pour aller au bord de la mer et déjeuner non loin de la plage. Mais j’ai une façon vraiment à moi de faire du tourisme, passer mon après midi au Taj à écrire, parfois sur leur joli papier à lettres, puis à regarder le soleil tourner puis s’abaisser, dans des nuances sublimes, sur les beaux quartiers.
De fait, je n’aime pas « visiter » les « points » à voir, et en Crète, par exemple, j’avais tendance à aller passer la journée à lire Racine dans le fort de Rethymnon comme si m’inscrire dans le paysage était ma seule occupation, au lieu de parcourir villes, églises et musées indiquées par les guides, ce que je ne faisais qu’à toute allure, par fournée expresse et bloquée, et par devoir. En fait, comme si je « vivais » dans le pays et non pas que je le « visitais ». Ici, j’emmènerai Racine sur le Golfe du Bengale et je relirai pour la deuxième fois en quinze jours, Bérénice, « Dans l’Orient désert quel devint mon ennui ». « Je suis venu vers vous sans savoir mon dessein. Mon amour m’entraînait, et je venais peut-être Pour me chercher moi-même, et pour me reconnaître ». Se reconnaître. Quel boulot.
Finalement un touriste seul, c’est rare. Les Européens, les Australiens, les Américains vont par deux ou par paquet.
Vendredi 27 janvier.
Reprenant l’art de tuer le temps, avec ou sans talent, j’ai si bien traîné depuis que je suis réveillée, qu’il est déjà 9 heures et demie. En Inde, c’est curieux, ce déséquilibre chaise/table, on est toujours au ras du menton dans son assiette, ou dans son écriture. Et le siège de chiottes follement haut, on est presque sur la pointe des pieds. En tout cas, je désenlaidis, je crois, un peu moins tirée, un peu moins verte, qu’à Delhi. Je me répète aussi à longueur de minutes que dans trois jours, je volerai vers Paris, que demain, je volerai vers le triste Delhi, étape nécessaire et chiante. J’irai peut-être (enfin, je retournerai) au Musée, histoire de tuer le temps. Car sinon, où ? Ni à Fort Rouge, plutôt mourir, ni dans ma chambre d’hôtel toute la journée
La télé est très mauvaise. Rien que des films américains, quelques clips indiens d’une débilité sans nom, quelques films hindis marrants à force d’être surjoués. Hier soir, une seule émission intéressante, un docu sur la fête nationale.
C’était tellement beau, ce Fisherman’cove. Une idée de milliardaire géniale, pour même pas 150 F tout compris. Ce déjeuner sublime sur la terrasse face à l’Océan Indien, l’enterrement solennel de tant de déceptions. Me rappeler Sadiq Pacha, ministre de la frontière ( ?), la tête de mafiosi des autres ministres, l’extraordinaire foule des supporters avec leurs drapeaux rouge/noir, débordant à pleins camions, la foule des mômes à la sortie de l’école, les touristes (dont moi) au Fischerman’cove. Je continue de m’émerveiller de la réparation de mes forces, le déjeuner de midi avec ce cocktail de papaye, les énormes crevettes délicieuses, le riz, face au tombeau somptueux de l’Océan Indien offert aux relations générales de ces derniers mois ou années, collection de gens égoïstes et lointains, avec des amours forcément lentes, ou faibles et amorties, « jouées » avec mes étudiants si bêtement contents de coucher avec la prof, mais bien sûr sans amour, il ne faut pas pousser, et, de ma part, pas de vrai désir, enfin, si un peu, juste ce qu’il faut mais pas plus, sans intérêt, petits frissons, petits mépris, petite puissance ; ou cette relation inexistante, jamais dite, de la part de certains de mes collègues masculins vieux jeu et coincés dont moi je n’avais pas envie, et qui m’agaçaient car je devais faire celle qui ne les voyais pas pour ne pas les mettre dans l’embarras ; ou la relation que je n’avais pas même envie de voir accomplie, avec S, qui était une nuance très particulière d’amitié, pas d’amour ou plutôt vaguement coloré d’inceste, relation pendant laquelle je trouvais ses relations indignes de lui, comme lorsque les mères déplorent le « meilleur ami » qu’elles trouvent indigne de leur fils.
Autrement dit, j’offre un tombeau à mes erreurs de relations, à la bêtise ou à l’indifférence des hommes de cette période de ma vie (1984/1988), heureusement qu’il n’en a pas toujours été ainsi et que j’en ai aimé qui valaient le coup. Un tombeau pour mes propres erreurs d’appréciation, mes illusions, pour ces 5 années. C’est elles que j’enterre dans l’Océan Indien. Noyées. Dissoutes dans les flopées d’eaux turquoise ; enterrées dans le sable beige qui les bordent. Je tasse. Je lisse. Ni fleurs, ni couronnes. Adieu !
En rentrant, je vivrai autrement.
Le comble du snobisme : lire Racine au bord de l’Océan Indien, la vie de milliardaire pour quelques heures, la couleur vert bleu de l’eau, le bruit des rouleaux, commander ce qu’on veut. Folie, folie, Callas et Traviata.
Un jeune homme aux yeux d’oiseau est venu me casser les pieds et me parler, me questionner sur la France, il devait flairer une touriste à promener, voire à s’envoyer pour lui tirer une pincée de dollars, il louche sur ma pierre de lune qu’il trouve magnifique, je lui dis qu’elle vient de ma mère, ce qui la rend sacrée à ses yeux sans doute car il cesse d’espérer que je vais la lui donner, la barbe, je finis par repartir vers le taxi et rentrer.
De petits temples à Shiva de ci de là, sur la route du retour. Du riz basmati sur le goudron. La ville au retour déborde de monde comme d’habitude. Trois millions d’habitants, au bord des bras de mer sales, des mômes qui jouent dedans, s’y roulent, en boivent, y pissent et le reste par surcroît, des rues sans trottoirs (contrairement à Delhi), des couleurs, de la poussière, des arbres, des vaches qui, ici, travaillent (contrairement à Delhi), elles tirent des chariots débordants.
A la télé, ils passent des danses indiennes assez chiantes, mais au moins je n’ai pas eu à sortir pour aller les admirer dans un théâtre pour touristes, je peux zapper sur les vieux feuilletons américains, qui passent sans relâche, ils ont dû leur vendre tous leurs fonds de tiroir, retour aux danses pour essayer de voir quelle est leur occupation spécifique de l’espace, comment on peut y entrer à son tour, je trouve chiants leur tremblotis de voix, et leurs clochettes, encore que, finalement, ça ait un vague air chinois qui me plaît. Excellente cuisine chinoise de l’hôtel. Le tout se mêle aux klacksons incessants de la ville, qui entrent par la fenêtre ouverte, bien que je sois au 12e étage. Les gens crient et font du bruit dans la rue, ils ne doivent jamais être chez eux, d’ailleurs c’est vrai dans les quartiers pauvres, ils sont tous à faire leurs trucs dehors, manger, se laver, laver, se salir, (les mômes), sans doute leurs maisons sont-elles trop sombres, trop petites et eux trop nombreux pour tenir dedans et d’où pourtant les hommes sortent vêtus de fringues blanches éclatantes, ce qui suppose que les femmes font un sacré boulot de blanchisserie. Mais c’est vrai ici aussi, quartier riche, comme si les quartiers pauvres étaient eux aussi à leur tour trop petits pour contenir leur énorme population, qui est d’ailleurs au service des quartiers riches où ils grappillent des roupies en faisant des petits boulots ou la manche.
Installer la climatisation avec son odeur fraîche de cave et son souffle à peu près doux. Lampe allumée, une certaine douceur, hélas demain je serai dans Delhi. Demain, ici, je me lave les cheveux. Au Hans Plaza, je pourrai écrire et regarder la télé. Et puis j’attendrai le coup de fil éventuel de ces sales cons [23]. J’espère qu’ils ne se précipiteront pas à Samarcande.
Les danseuses créent de l’espace autour de certaines d’entre elles, qu’elles enferment ou non, créant du visible/invisible.
La nuit poussiéreuse et nacrée tombe sur les palmiers dans un couchant jaune et rouge mélangé. Tristes tropiques comme le dit si bien Lévi-Strauss. Il faut que je le relise, s’il parle de l’Inde, je ne suis pas sûre, il parle de l’Amérique comme mauvaise conscience de l’Occident, peut-être de l’Inde pour la mort ?
Jaune rose grisé comme du pastel pas fixé. De plus en plus éteint et moins illuminé. Le ciel du matin est joli aussi mais moins doux. J’aime assez la chaîne de télé, celle des nouvelles avec leur fond (débilement employé) de musique classique.
J’ai lu une fois encore Alexandre le Grand (Racine) qui est assommant. Puis la tirade finale d’Antiochus, sublime ; au bord de l’océan, tout était à la fois si proche et les rois de l’Inde en carton du XVIIe siècle, que même les tirades assommantes de Cléophile, Taxile et compagnie me paraissaient lisibles. D’ailleurs, Taxile, le traître, est une de ces figures raciniennes faibles, un peu comme une esquisse de Bajazet, ces hommes éperdus par les femmes et perdus par elles et il s’en trouve aussi dans Mithridate, qui, elle aussi, est une pièce un peu ennuyeuse.
Ce cahier est comme un mode d’emploi d’un temps en trop, comment le faire passer en l’égrenant, en le morcelant, le comptant et le recomptant. Le parlant (avec Henri), l’écrivant (pour moi).
Beethoven, le concerto de l’Empereur, sur fond de ciel buvard gris et palmiers. Comment en sont-ils passés à une espèce de galop à trois temps. Mystère des enchaînements indiens. À présent le Boléro de Ravel pour accompagner en fond sonore les taux de change.
Et voilà, je suis revenue avec 5 cartes postales [24].
Je crois que j’irai quand même à l’aéroport de Delhi à l’heure dite, quel que soit le message de la Thaï, s’il y en a un.
Samedi 28 janvier.
Le jour radieux se lève sur Madras, ses palmiers, ses cocotiers, ses couleurs, le tout merveilleusement tamisé par le Taj. J’ai très bien déjeuné, j’avais très bien dîné (restaurant chinois de l’hôtel, décidément j’aime beaucoup cette cuisine), je suis très sage, je mange, une cuiller pour Papa, une cuiller pour Maman, une cuiller pour qui ?
J’attends devant la télé que le temps de l’aéroport arrive en regardant Autant en emporte le vent. Mon voyage devient surréaliste, à force de refuser de m’inscrire dans ce foutu pays. Je commence à m’interroger sur ce que je vais bien pouvoir faire demain, de ma dernière journée. Porter le paquet à Jeannine [25] ? Bon, voilà Mélanie est morte, le film égrène ses amours inconsommées, mal consommées, décalées, perdues, gâchées. C’est vrai, rien de pire que ce qui aurait pu être et n’a pas été. J’ai rêvé à D. [26], quelle ânerie ça aussi. Distrayant par moments, mais globalement idiot.
Je vais commencer à planifier Paris. Laver mes affaires rapidos, les débarrasser de leur horrible odeur indienne. Téléphoner aux amis, planifier un dîner chez moi. Penser film sur trahison – thème majeur - et aller le voir au cinoche (lequel note 2013 ?). Lili Marlene jouée en sourdine au « Pavillion » (une partie de l’hôtel).
Aéroport de Madras, très cool, le type avec son paquet en cornes de buffle ( ?). Les hommes avec leurs chachis-case (?). Vivement l’aéroport de Delhi demain soir. J’en rêve.
Je vois d’en haut les Ghâtes orientales, nappes de lave immenses qui descendent effectivement en marches énormes vers le Golfe du Bengale turquoise. Arrêt technique à Hyderabad, je range ce petit calepin annexe.
Au Hans Plaza, regret du Taj, de ses moquettes, de ses corbeilles de fruits, de ses roses, de la salle de bains somptueuse et de sa délicieuse cuisine chinoise dont je ne me suis pas lassée. Je me réhabitue à la classe moyenne, très moyenne.
4. Adieux
Dimanche 29 janvier.
Retrouvé hier l’Inde du Nord, la télé geignarde et ses films hindis. Petit déjeuner, puis commencé le compte à rebours, par heure, cette fois-ci de cette dernière journée en Inde. Les acteurs sont gras, et ressemblent à des sous-marques d’Enrico Macias, c’est dire. Les femmes, idiotes. Caméra avec des travelling arrière et avant, d’un monotone à pleurer. Chant d’oiseaux, eau jaillissante.

Dans le journal, (The Hindoustan Sunday Time), ils esquintent le festival de films, « Who cares for the Film Festival » ? Ils se plaignent qu’il n’y avait aucun forum de discussion digne de ce nom, organisation labyrinthique, aucune envie de se rencontrer, les réalisateurs ne sont restés que le strict jour de la projection de leur œuvre. Ah, dit l’auteur, le Festival n’est plus ce qu’il était, en citant quelques-uns des films les plus marquants.
Le feuilleton-film à la télé se déroule inexorablement. L’homme gras aux yeux fixes est pris de très près, elle, les yeux levés au ciel d’un air rêveur, chacun dans un coin de jardin ; au bout de quelques travelling, il a fini par apercevoir la bonne femme. Il a l’air très troublé, elle, apeurée et con. Il lui met la main sur l’épaule, il la prend dans ses bras et ah, nom de Dieu, il a un infarctus, elle pleure. Arrive une amie. Puis un couple. Ils sont quatre maintenant plus le mort. Et allons-y en travelling avant, c’est le centième depuis le début de l’histoire, elle est hyper-démonstrative, elle pleure en levant les yeux au ciel (faut le faire !) pendant au moins cinq minutes. Plan d’oies sauvages dans le ciel. Puis plans ext. de l’enterrement, travelling latéral sur les assistants, le corps est aperçu rapidement, flammes, pleurs, au plan suivant, une bande de prêtres en orange. Au plan suivant, elle a les yeux bandés, elle est encadrée par deux hommes très habillés, avec des vestes très cintrées, des colliers, tous pleurent. Plusieurs travelling latéraux et frontaux sur les bûches, et les assistants pleurent, puis plan de remise des cendres, tous montent au temple, moines oranges et civils en blanc. Voici un aveugle que j’avais vu au début quand j’avais mis la télé, qui roule aussi des yeux blancs vers le ciel, et elle, les yeux toujours bandés. Elle se précipite aux pieds de l’aveugle. C’est débile. Ca fait 25 minutes montre en main que tous pleurent, en plan groupé ou isolé. Plan final, fixe. C’était Mahabharata serial en hindi. L’amour en Inde. Rigolade lugubre.
Suit un feuilleton américain qui n’a pas l’air mieux que le hindi. Sauf que les larmes durent 20 secondes au lieu de 5 minutes. Au loin par la fenêtre, je vois la mosquée, je continue à la trouver horrible. Dire que même au-dessus de Connaught Place, il y a des vautours, on en verrait planer au-dessus de l’Étoile ?
Beaucoup de films en costume.
Il est 2 h ¼. Le pied ! À part le syndrome de la chute du jour, que j’occuperai en descendant au Travel Desk ; je ne prévois rien de grisant ni de fâcheux. Après, je me changerai, je me doucherai et en avant toute. Peut-être ce cahier tout entier prendra-t-il le chemin de la poubelle en rentrant, hormis quelques notes sur la matière filmique [27] et son approche.
Cette chambre est au Nord, d’un froid vraiment pas possible. Tout de même trois semaines curieuses, d’un certain côté, j’ai vu les limites au delà desquelles l’ocnophile est en péril, manque d’objet, rétrécissement sur l’objet lui même c’est-à-dire une survalorisation de mon intégrité que la moindre étrangeté mettait en péril, et aussi le philobate qui sommeillait en chacun et qui exige un minimum d’accord avec le milieu, qui, sinon, ne peut absolument pas jouer le rôle de milieu nourricier. D’où péril hors de la demeure et pas dedans. J’ai rêvé cette nuit que j’étais à Domblans, je devais coucher chez Yvette Écoiffier, il y avait aussi la grange de Mme Chevassus où mes cousins Corpet, Philippe et François, faisaient répéter je ne sais quelle comédie et de la poésie à des petites filles, comme autrefois les petites Daudon pendant la guerre. Sur une planche, il y avait un verre de lait, ou de lait caillé ( l’horrible lassi, peut-être, beurk) que je refusais absolument de boire.
Je regarde la circulation, ça y est, encore un accident, un bonhomme à moitié mort sans doute, tombé d’un rickshaw, bousculé par le choc d’une voiture et d’un bus, quel sinistre pays.
Au loin, la mosquée s’aplatit un peu dans la lumière du sud-ouest qui la frappe et l’adoucit, dans son aspect métallique et froid, par rapport à ce matin. Par rapport aux mosquées du Maghreb, c’est vrai, je ne l’aime pas. La télé indienne, des séries débiles, des interviews de merde, des cadres pas « cadrés », des studios cheap, la bonne femme de Madras lisant de profil ses petits papiers devant son micro en s’adressant à un mec assis à côté. Incroyable, on se croirait dans les débuts de la télé, il y a 40 ans.
Changer la jaquette de mon Racine, déchirée, effritée, trop tripotée. La transparente, s’entend. Hier au dessus des Ghâtes orientales, j’ai relu Mithridate, Xipharès, Monime. Alexandre est-il juste embêtant ou carrément mal foutu ? Heureusement que j’ai lu un bout d’Antiochus sur la plage.
Je descends au Travel Desk. Après je commanderai un poisson (rôti), ce serait une idée, et ce serait un dîner, de toute façon.
Le dessein en est pris, « Je pars, cher Théramène », la Thaï n’a pas de retard. OK OK.
Vingt-cinq ans plus tard
(Ajouté en 2013, en recopiant le cahier rouge)
Le journal s’était arrêté là. Mais je me rappelle la dernière soirée avec une merveilleuse clarté.
Je suis arrivée très en avance à l’aéroport. Il a fallu payer une somme exorbitante (non prévue) pour les taxes locales d’aéroport, heureusement que j’avais gardé du liquide. Après je suis allée dans la salle d’attente où j’ai fait la connaissance d’une jeune et belle fille, dans les vingt-cinq/trente ans, qui venait de passer six mois à voyager seule, en hippie un peu aisée, dans l’Asie du Sud Est, Bali, Sumatra, Thaïlande, elle était arrivée chez son père, un homme d‘affaire français basé à Calcutta. Elle ne connaissait pas l’Inde, mais tout de suite, à peine débarquée, elle a haï ce pays, ne l’a pas supporté, par le fait qu’elle haïssait cette misère-là, serrée à la gorge par un conservatisme, une acceptation, une fatalité, la misère qui est l’air qu’on respire, écœurée par la manière dont les gens de Calcutta l’acceptaient comme leur destin, sans rechigner, sans révolte, trop faibles, trop pauvres, trop malades, anesthésiés par le mysticisme, elle a vu le mensonge des légendes hippies, les bâtons d’encens, les grigris, dont ils se paraient avec une inconscience et une naïveté sans borne. Elle s’est sentie si mal qu’elle a décidé de rentrer immédiatement, alors qu’elle avait prévu d’aller d’abord de Calcutta à Bombay et de faire ensuite tout le tour de l’Inde par le Sud, avant de repartir de Calcutta. Mais non, impossible, un dégoût viscéral, étouffant, paralysant, stupéfiant. Ça puait l’éternité et la soumission. Pourtant, elle avait une sacrée expérience des voyages seule, et de l’Asie. A Delhi, elle a sauté dans un avion pour ne plus voir ce foutu pays et rentrer en France.
Comme je la comprenais ! Elle a réagi en fait comme moi, prise d’une haine des Indiens, du pays et de leur condition politique et religieuse, écrabouillés dans leurs temples, dans leurs castes et leurs dévotions, leurs gourous, leurs divinités et leur poussière, leur eau pourrie, leurs mouches et leurs mendiants, qui fait qu’on les hait parce qu’on se hait de les haïr. Nous avons chuchoté notre épouvante une partie de la nuit, près des hublots du fond de l’avion, en buvant des verres d’eau, nous avions subi la même horreur, perçu la même violence désespérée, et nous étions en train de nous en échapper. Et moi, j’échappais doublement, car, en fuyant ce monde, je jetais dans cette poubelle un aspect déplaisant de moi, celui qui se ratatine, me jurant de ne pas me remettre dans le contexte qui le provoque, ici, l’extrême pauvreté et l’extrême écrasement du monde, qui prolifère masqué et repeint par le discours fumeux et émerveillé de tant d’Occidentaux. Le mot même de l’Inde depuis 1989 déclenche une allergie dans ma tête.
Pendant que nous décollions, j’ai regardé Delhi, piquetée de ses lumières dans la nuit froide, la ville infinie s’éloignait dans le halo brouillardeux de la pollution, et, au fur et à mesure que nous élévions, je me suis dit : « Jamais, plus jamais, je n’y retournerai. » [28].
Notes
[1] Note 2013 ; perte symbolique, s’il en est.
[2] (Note 2013) Film de Satyajit Ray, sorti en 1973, mais que j’avais dû revoir en 1985. Très beau mais sinistre, avec la grande famine du Bengale dans les années 40. L’Inde est toujours en train de mourir.
[3] (Note 2013) J’en ai fait aussi une série de cours en rentrant, il est sorti en France sous le nom de Faux Semblants. J’ai alors vu les sous-titres et constaté que j’avais plutôt bien compris.
[4] (Note 2013) J’avais payé d’avance dans ce bouge, où c’était la règle. La dame m’a remboursée quand je suis partie. Mais j’aurais tout abandonné pour le plaisir de les quitter.
[5] (Note 2013) Maurice Olender dirigeait au Seuil la collection Textes du XXe siècle et m’avait demandé de lui donner un manuscrit sur le sujet qui me plairait.
[6] (Note 2013) La compagnie d’aviation pour rentrer à Paris.
[7] (Note 2013) Écrites à Red Fort sur de minuscules pages quadrillées arrachées à un mini-carnet Rhodia.
[8] (Note 2013) Un quartier « typique » de Delhi.
[9] (Note 2013) Faux, j’ai « accroché » positivement avec la Chine immédiatement, qui est pourtant, elle aussi, un monde si différent.
[10] (Note 2013) Pascal Quignard faisait cet hiver là à l’EHESS un cours sur le roman romain, que je suivais avec un grand intérêt, c ‘était à la fois si décalé par rapport à mes recherches ; et si proche en même temps. Fiction, récit etc.
[11] (Note 2013) Allusion à la première version de L’Embarquement pour Cythère, que j’avais finie peu avant, et qui a souvent changé de titre avant que je le mette en ligne.
[12] (Note 2013) A l’époque, sans tenir régulièrement de journal, j’avais un cahier où j’essayais de développer parfois par écrit les choses qui me faisaient problème. Ou des feuilles volantes, que je ne conservais pas.
[13] (Note 2013) Mes collègues indianistes de l’EPHE.
[14] (Note 2013) Pour confirmer mon vol de retour en France. Cela m’obsédait.
[15] (Note 2013) Depardieu était venu à cause de Satyajit Ray (dont il devait co-produire un film, Les Branches de l’Arbre) et avec Toscan du Plantier. J’avais dû être invitée à cause de ma présence au Festival. À l’Ambassade. Ras le bol d’India Song.
[16] (Note 2013) Ces tableaux donneront l’article paru dans Sciences sociales et santé en décembre 1991, vol. IX, n°4, « Sexualité et maladie, un court circuit dans le monde filmique ».
[17] (Note 2013) Je parle de la chambre du Taj Coromandel, LE divin palace de Madras. En fait, si, j’ai pu y rester, ils m’ont gardée, une de leurs réservations s’est décommandée. .
[18] (Note 2°13) C’était un feuilleton qui passait en France sur la 2 le matin, et que je regardais dévotement, elles aussi, mais en Australie où le feuilleton était tourné. Elles étaient de Sydney. Nous avions parlé de la beauté de l’opéra sur la mer.
[19] (Note 2013) Je ne sais pas de qui est cette citation. À distance, je l’approuve encore davantage. Les dieux hindous sont des bandits. Des bandits acceptés, révérés.
[20] (Note 2013) Pourtant Michel Combes, qui y était allé, m’en avait vanté le charme incroyable, la puissance envoûtante. Les « Indophiles » sont forcément partiaux.
[21] (Note 2013) Trois jeunes gens dans les 18/20 ans, sur la plage, m’avaient demandé la permission de me photographier, avec la mer derrière moi.
[22] (Note 2013) Il s’agit toujours des personnages de L’Embarquement pour Cythère
[23] (Note 2013) Je pense qu’il s’agit de l’aéroport, à la Thaï, pour savoir s’ils auraient du retard.
[24] (Note 2013) Achetées à la boutique de l’hôtel. La plupart des cartes que j’ai envoyées ne sont pas arrivées, les employés des Postes, parait-il, décollaient les timbres et les revendaient ??
[25] (Note 2013) Je l’ai envoyé de Paris, je l’aurai donc trimballé pour rien, symbole de ce déplacement absurde.
[26] (Note 2013) C’était un de mes étudiants, je me l’envoyais dans les années où JJ me faisait tourner en bourrique, sorte de compensation sexuelle, mais il était assez bête et prétentieux finalement.
[27] Eh bien non, je l’ai gardé et, témoin, je peux le recopier maintenant !!
[28] Résolution tenue.